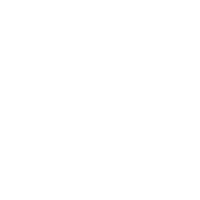Recherche
Textes des lauréats
Contenu en cours d'élaboration
Niveau 6ème
Sujet n° 1
Aure GADY, collège du Vallon, AUTUN
Le dernier voyage
Amis, nobles, paysans, riches, pauvres, une foule énorme vient me saluer devant le port. Tous me souhaitent un bon voyage. Je suis triste de quitter un si bel endroit et toute cette population. Mes yeux derrière mon masque laissent couler une larme. On m'a installé sur une grande felouque, arrondie aux extrémités. Elle a un mât solide, de nombreux cordages et est ornée avec du papyrus. La felouque s'éloigne lentement d'Abou-Simbel sous les cris des enfants et les pleurs des femmes. Sur les deux rives du fleuve, les fellahs accourent pour me saluer.
Le voyage commence. Derrière moi, j'imagine les colosses du temple diminuer peu à peu au fur et à mesure que nous nous éloignons. Le Nil traverse à présent un désert aride. Seules les terres inondées par la crue donnent naissance à des champs irrigués qui vont fertiliser la campagne. Nous arrivons à Philae à proximité de la cataracte. Le fleuve ne devient plus navigable. Il faut descendre de la felouque à cause des gros rochers. Matelots, prêtres, amis, porteurs, tout le monde est à terre. On emporte mon lit sur le chemin le long du Nil sous les applaudissements de la foule. Je sens le parfum délicieux des lauriers roses et des acacias. J'aperçois au loin les pylônes du temple d'Isis qui me rassure et me protège. Plus loin, nous gagnons une nouvelle felouque.
Nous arrivons maintenant à Assouan. Cette si belle ville me fait oublier la tristesse de devoir abandonner ce pays. Je suis content d'admirer les temples de Satet, de Khnoum et d'Heqaib, même si je suis triste à l'idée que c'est la dernière fois. Je distingue aussi trois îles magnifiques au milieu du Nil, dont la belle Eléphantine.
Il faut poursuivre le voyage et continuer de descendre le fleuve. Des chasseurs chassent les hippopotames et les crocodiles le long des berges. Nous les regardons. Plus jamais je ne pourrai faire comme eux. Nous arrivons à Kôm Ombo qui domine une boucle du Nil. Je suis émerveillé par les bouquets de palmiers, les lotus, les papyrus dans lesquels vivent les flamants. Les maisons des habitants s'accordent bien dans le paysage. Au milieu de la ville, un temple majestueux possède une grande porte de hiéroglyphes avec, pour garder l'entrée, deux longues rangées de sphinx impressionnants. Je me revois parader dans cette allée royale. A l'intérieur du temple, des pylônes grandioses ornent la cour. C'est un temple splendide qui me rappelle tant de souvenirs.
Mais il faut continuer notre route toujours vers notre destination finale. J'observe des hommes et des femmes qui récoltent des plantes. Au passage de notre barque, ils nous saluent, pleurent ou crient. Nous distinguons la silhouette de Djebel el Silsilèh qui découvre les colonnes d'un temple. Elles sont ornées des corps et des têtes des dieux. Malgré ma tristesse, je me réjouis d'apercevoir encore tant de beautés.
La felouque continue chaque jour un peu plus sur le Nil. Sans voir le temps passer, je me rends compte que nous arrivons déjà à Edfou. Le magnifique temple et ses gigantesques colonnes me touchent comme si je les voyais pour la première fois. Là encore, nous n'avons pas le temps de rendre le culte à tous ces dieux et il nous faut quitter à regret ces lieux merveilleux. A Kôm el Amar, je passe devant une splendide maison avec, tout autour, un lac et des nénuphars en fleurs. Au fond, je vois les palmiers puis le désert. De superbes oiseaux aux plumes multicolores volent dans le ciel bleu. Un peu plus loin, la grande ville d'El-Kab nous indique que nous toucherons bientôt au but. La ville est riche d'innombrables temples comme ceux d'Hathor et de Nekhet, si impressionnants et qui me doivent beaucoup.
Plus loin, j'aperçois Esna avec son grand temple dédié à Khnoum. Sa porte est décorée de magnifiques bas-reliefs. Beaucoup de souvenirs me rattachent à ce temple que je n'oublierai jamais. Notre felouque croise une barque de chasseurs qui remontent le Nil à la recherche de gibiers cachés dans les roseaux. Nous passons devant les tombeaux d'Ankhiti et de Sebekhotep avant d'arriver à Gebelein. J'aperçois de nombreux tombeaux ainsi qu'un autre temple d'Hator. De nombreux oiseaux, flamants et mouettes volent dans les airs près du fleuve. Nous voici maintenant à Tôd où j'ai fait agrandir le temple en l'honneur de Montou. Ses prêtres m'apportent les présents qui me seront bientôt indispensables. Nous quittons ce lieu pour notre dernière étape. A nouveau, poissons du Nil, oiseaux multicolores et plantes variées au milieu des roseaux constituent mon paysage préféré depuis le début du voyage. Les femmes cueillent des fleurs de nénuphars et me les lancent depuis les rives. Le fleuve se couvre de pétales.
Enfin, nous arrivons à Thèbes, la ville aux 100 portes, but ultime de notre voyage. La ville est très grande au milieu des palmiers. Ses habitants sont déjà nombreux, mais des milliers d'Egyptiens sont aussi venus de tout le pays et m'attendent depuis plusieurs jours que la nouvelle a été annoncée.
Nous débarquons sur le quai et nous dirigeons vers les grands temples de Louxor et de Karnak. Toute la ville nous attend. Tout le monde prie avec moi. Les offrandes aux dieux sont nombreuses. C'est un mélange de tristesse et de fête.
Ce matin, tout le monde s'est levé de bonne heure. La foule s'est rassemblée sur le port de Thèbes. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Les plus pauvres attendent dans des rues très loin d'ici. J'ai la place de choix sur mon lit et les rayons du soleil illuminent mes vêtements en or. On me porte sur une felouque pour me faire traverser le fleuve. Des milliers d'autres bateaux nous suivent. Une fois l'autre rive atteinte, un cortège mené par les prêtres me conduit dans la grande vallée des rois. Toute ma famille est derrière moi. On entend les prières et les chansons. Le cortège monte dans la montagne thébaine. Les prêtres entrent et descendent les marches conduisant à ma chambre. Les formules sont prononcées. Les offrandes sont déposées. Les rites les plus anciens sont respectés avant le départ de tous. Seul le grand prêtre demeure une dernière fois. Il part lui aussi. Un sentiment de peur m'envahit. Avant d'entendre la lourde dalle se refermer pour toujours, le prêtre proclame : « voici ta demeure pour l'éternité, ô mon maître, Seigneur des Deux pays, fils de Rê, Roi de Haute et de Basse Egypte, Ramsès le Grand ».
La felouque continue chaque jour un peu plus sur le Nil. Sans voir le temps passer, je me rends compte que nous arrivons déjà à Edfou. Le magnifique temple et ses gigantesques colonnes me touchent comme si je les voyais pour la première fois. Là encore, nous n'avons pas le temps de rendre le culte à tous ces dieux et il nous faut quitter à regret ces lieux merveilleux. A Kôm el Amar, je passe devant une splendide maison avec, tout autour, un lac et des nénuphars en fleurs. Au fond, je vois les palmiers puis le désert. De superbes oiseaux aux plumes multicolores volent dans le ciel bleu. Un peu plus loin, la grande ville d'El-Kab nous indique que nous toucherons bientôt au but. La ville est riche d'innombrables temples comme ceux d'Hathor et de Nekhet, si impressionnants et qui me doivent beaucoup.
Plus loin, j'aperçois Esna avec son grand temple dédié à Khnoum. Sa porte est décorée de magnifiques bas-reliefs. Beaucoup de souvenirs me rattachent à ce temple que je n'oublierai jamais. Notre felouque croise une barque de chasseurs qui remontent le Nil à la recherche de gibiers cachés dans les roseaux. Nous passons devant les tombeaux d'Ankhiti et de Sebekhotep avant d'arriver à Gebelein. J'aperçois de nombreux tombeaux ainsi qu'un autre temple d'Hator. De nombreux oiseaux, flamants et mouettes volent dans les airs près du fleuve. Nous voici maintenant à Tôd où j'ai fait agrandir le temple en l'honneur de Montou. Ses prêtres m'apportent les présents qui me seront bientôt indispensables. Nous quittons ce lieu pour notre dernière étape. A nouveau, poissons du Nil, oiseaux multicolores et plantes variées au milieu des roseaux constituent mon paysage préféré depuis le début du voyage. Les femmes cueillent des fleurs de nénuphars et me les lancent depuis les rives. Le fleuve se couvre de pétales.
Enfin, nous arrivons à Thèbes, la ville aux 100 portes, but ultime de notre voyage. La ville est très grande au milieu des palmiers. Ses habitants sont déjà nombreux, mais des milliers d'Egyptiens sont aussi venus de tout le pays et m'attendent depuis plusieurs jours que la nouvelle a été annoncée.
Nous débarquons sur le quai et nous dirigeons vers les grands temples de Louxor et de Karnak. Toute la ville nous attend. Tout le monde prie avec moi. Les offrandes aux dieux sont nombreuses. C'est un mélange de tristesse et de fête.
Ce matin, tout le monde s'est levé de bonne heure. La foule s'est rassemblée sur le port de Thèbes. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Les plus pauvres attendent dans des rues très loin d'ici. J'ai la place de choix sur mon lit et les rayons du soleil illuminent mes vêtements en or. On me porte sur une felouque pour me faire traverser le fleuve. Des milliers d'autres bateaux nous suivent. Une fois l'autre rive atteinte, un cortège mené par les prêtres me conduit dans la grande vallée des rois. Toute ma famille est derrière moi. On entend les prières et les chansons. Le cortège monte dans la montagne thébaine. Les prêtres entrent et descendent les marches conduisant à ma chambre. Les formules sont prononcées. Les offrandes sont déposées. Les rites les plus anciens sont respectés avant le départ de tous. Seul le grand prêtre demeure une dernière fois. Il part lui aussi. Un sentiment de peur m'envahit. Avant d'entendre la lourde dalle se refermer pour toujours, le prêtre proclame : « voici ta demeure pour l'éternité, ô mon maître, Seigneur des Deux pays, fils de Rê, Roi de Haute et de Basse Egypte, Ramsès le Grand ».
Sujet 2
Eva DI LEO, Collège Changarnier, Autun
Cauchemar à Pompéi
Je m'appelle Urcius, j'ai dix-sept ans, je suis le fils d'Alcibian, sculpteur attitré de la province de Pompéi.
Un matin de l’an 79, mon père me demanda de livrer une statuette commandée par le gouverneur de la province. Cette mignonnette, d’une longueur d’un pied , représentait Diane, la déesse de la chasse.
Sans hésitation, je me rendis à dos d'âne à sa demeure. Arrivé à destination, je fus accueilli par le gouverneur et sa charmante fille, Eilistraée. Elle était grande, mince aux yeux bleus aussi profonds que l'océan. Sa chevelure, si blonde, donnait l'illusion qu'elle était faite d'or. Sa peau blanchâtre, presque bleutée, était semblable à la lune par une nuit d'hiver.
Elle est magnifique !, pensai-je.
Sans hésitation, je me rendis à dos d'âne à sa demeure. Arrivé à destination, je fus accueilli par le gouverneur et sa charmante fille, Eilistraée. Elle était grande, mince aux yeux bleus aussi profonds que l'océan. Sa chevelure, si blonde, donnait l'illusion qu'elle était faite d'or. Sa peau blanchâtre, presque bleutée, était semblable à la lune par une nuit d'hiver.
Elle est magnifique !, pensai-je.
Le gouverneur m'invita à entrer.
«Voilà cette statuette enfin terminée !, s'exclama t-il, en posant celle-ci sur la table basse en marbre de Carrare dont les contours polis étaient aussi doux que la peau d'un nouveau né. Combien dois-je à ton père?
- 35 pièces d'or ». Il sortit l'appoint d'un petit coffret d'ivoire ornant la table basse qui se trouvait devant lui.
D'un signe de tête, il me remercia.
Avant de quitter la demeure, je me dirigeai vers les appartements d'Eilistraée.
En me voyant, elle m'adressa un grand sourire. Elle s'empressa de m'inviter à jouer à une sorte de jeu constitué de pièces de bois .
« Eilistraée, avouai-je d'une voix tremblante, ignorant le plateau qu'elle me tendait, je ne sais comment te le dire. Depuis le premier jour, je ne pense qu'à toi, tu hantes mes rêves, je suis charmé par toi, par ta beauté..., je t'aime.
- J'en suis flattée, très cher, mais je n'éprouve aucune attirance pour le fils d'un sculpteur. Jamais, tu entends, jamais mes sentiments ne seront pour toi ! La nature m'a promis un meilleur avenir », dit-elle pleine de mépris et d'orgueil dans la voix.
Elle se retira sans se retourner, c’en était bien assez pour moi et je décidais de rentrer chez moi, désespéré par cette triste journée.
«Voilà cette statuette enfin terminée !, s'exclama t-il, en posant celle-ci sur la table basse en marbre de Carrare dont les contours polis étaient aussi doux que la peau d'un nouveau né. Combien dois-je à ton père?
- 35 pièces d'or ». Il sortit l'appoint d'un petit coffret d'ivoire ornant la table basse qui se trouvait devant lui.
D'un signe de tête, il me remercia.
Avant de quitter la demeure, je me dirigeai vers les appartements d'Eilistraée.
En me voyant, elle m'adressa un grand sourire. Elle s'empressa de m'inviter à jouer à une sorte de jeu constitué de pièces de bois .
« Eilistraée, avouai-je d'une voix tremblante, ignorant le plateau qu'elle me tendait, je ne sais comment te le dire. Depuis le premier jour, je ne pense qu'à toi, tu hantes mes rêves, je suis charmé par toi, par ta beauté..., je t'aime.
- J'en suis flattée, très cher, mais je n'éprouve aucune attirance pour le fils d'un sculpteur. Jamais, tu entends, jamais mes sentiments ne seront pour toi ! La nature m'a promis un meilleur avenir », dit-elle pleine de mépris et d'orgueil dans la voix.
Elle se retira sans se retourner, c’en était bien assez pour moi et je décidais de rentrer chez moi, désespéré par cette triste journée.
Je ne pouvais m'empêcher de me souvenir des longues journées passées avec Eilistraée quand nous étions enfants. Nous courrions dans les allées de la grande demeure dont je connaissais les moindres recoins. Où était donc passée la jeune fille si douce et si frêle dont le rire résonnait au plus profond de mon être ?
« Qu'y a-t-il Urcius? Quelle est cette mine? La commande n'était-elle pas convenable ?, s'empressa de demander mon père à mon retour.
- Non. Tout est en ordre, le gouverneur t'est reconnaissant et passera bientôt pour une nouvelle commande.
- Va te coucher, me conseilla-t-il, rassuré. Demain, nous devons aller à Napoli pour livrer la famille princière. Tout doit être en ordre, sinon... ».
Cette nuit-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Toutes mes pensées étaient tournées vers la belle Eilistraée. Ses propos m'avaient brisé le cœur, je ne pouvais me résigner à l'oublier.
- Non. Tout est en ordre, le gouverneur t'est reconnaissant et passera bientôt pour une nouvelle commande.
- Va te coucher, me conseilla-t-il, rassuré. Demain, nous devons aller à Napoli pour livrer la famille princière. Tout doit être en ordre, sinon... ».
Cette nuit-là, j'eus du mal à trouver le sommeil. Toutes mes pensées étaient tournées vers la belle Eilistraée. Ses propos m'avaient brisé le cœur, je ne pouvais me résigner à l'oublier.
Le lendemain, nous partîmes pour Napoli. Le trajet, bien que court, était périlleux car la commande de vingt livres représentant le buste du prince était posée en équilibre sur le dos de notre âne courageux. Nous arrivâmes à Napoli et nous nous rendîmes directement au Palais Royal pour livrer la commande. Nous fûmes conduits par des gardes dans un grand salon orné de magnifiques tapisseries représentant, sans doute, des batailles passées. Nous y attendîmes le Prince.
« Excellence, le salua mon père, tout en inclinant le buste.
- Salutation, très cher, lança-t-il en entrant dans la pièce d'un pas assuré. Qui est donc cette jeune personne, Alcibian ?
- Je vous présente mon cher fils, Urcius, qui reprendra l'affaire familiale, plus tard, l'informa mon père fièrement. Je rougis, gêné.
- Ma commande est-elle prête?, demanda-t-il en tendant un verre qu'un serviteur s'empressa de remplir d'un nectar carmin.
- Oui, Seigneur, vos gardes l'ont déposée dans le vestibulum
- Seras-tu des nôtres, ce soir, pour la fête des vendanges? »
Mon père déclina l'invitation, prétextant des travaux en retard à l'atelier. En réalité mon père était inquiet de l'activité anormale du mont Vésuve En effet, depuis quelques jours déjà, quelques secousses se faisaient sentir et des ronflements accompagnaient des coulées de lave.
« Excellence, le salua mon père, tout en inclinant le buste.
- Salutation, très cher, lança-t-il en entrant dans la pièce d'un pas assuré. Qui est donc cette jeune personne, Alcibian ?
- Je vous présente mon cher fils, Urcius, qui reprendra l'affaire familiale, plus tard, l'informa mon père fièrement. Je rougis, gêné.
- Ma commande est-elle prête?, demanda-t-il en tendant un verre qu'un serviteur s'empressa de remplir d'un nectar carmin.
- Oui, Seigneur, vos gardes l'ont déposée dans le vestibulum
- Seras-tu des nôtres, ce soir, pour la fête des vendanges? »
Mon père déclina l'invitation, prétextant des travaux en retard à l'atelier. En réalité mon père était inquiet de l'activité anormale du mont Vésuve En effet, depuis quelques jours déjà, quelques secousses se faisaient sentir et des ronflements accompagnaient des coulées de lave.
Quelques jours plus tard, en fin d'après-midi, le gouverneur vint avec sa fille pour passer une nouvelle commande. Ils désiraient une statue représentant Vénus, la déesse de l'amour.
Ils attendaient tous deux sur le seuil de l'atelier quand, soudain, un grondement sourd, comme provenant du centre de la terre, se fit entendre ! Le sol se mit à trembler. En un
instant, les murs de notre maison se fissurèrent.
Nous nous demandions quelle était la cause de ce chaos.
« ... Le Vésuve ! », s'écria mon père.
De loin, nous voyions le magma s'écouler sur les flancs rocheux du volcan en éruption. Des gerbes de pierres étaient expulsées du cratère. Le volcan grondait avec toujours plus d'intensité. C'était la panique dans les rues, on criait et on courait pour échapper à une mort probable.
Une femme, affolée, tenant ses deux nourrissons blottis contre sa poitrine, tentait malgré tout de les rassurer en les couvrant de baisers protecteurs. Je lus la peur dans ses yeux, la peur de perdre le trésor de toute sa vie.
Un cheval en fuite dévalait au grand galop la rue principale où nous nous trouvions. Ses sabots frappaient les pavés taillés grossièrement dans la pierre. Il fit une embardée, percutant un couple de vieillards, les projetant à terre.
Ils attendaient tous deux sur le seuil de l'atelier quand, soudain, un grondement sourd, comme provenant du centre de la terre, se fit entendre ! Le sol se mit à trembler. En un
instant, les murs de notre maison se fissurèrent.
Nous nous demandions quelle était la cause de ce chaos.
« ... Le Vésuve ! », s'écria mon père.
De loin, nous voyions le magma s'écouler sur les flancs rocheux du volcan en éruption. Des gerbes de pierres étaient expulsées du cratère. Le volcan grondait avec toujours plus d'intensité. C'était la panique dans les rues, on criait et on courait pour échapper à une mort probable.
Une femme, affolée, tenant ses deux nourrissons blottis contre sa poitrine, tentait malgré tout de les rassurer en les couvrant de baisers protecteurs. Je lus la peur dans ses yeux, la peur de perdre le trésor de toute sa vie.
Un cheval en fuite dévalait au grand galop la rue principale où nous nous trouvions. Ses sabots frappaient les pavés taillés grossièrement dans la pierre. Il fit une embardée, percutant un couple de vieillards, les projetant à terre.
Paniquée, Eilistraée s'élança dans la marée humaine qui courait désespérément vers le port. Son beau visage, couvert de cendres, laissait deviner la trace des larmes qu'elle ne pouvait contenir. Quelques mèches de ses cheveux emmêlés cascadaient devant ses yeux et sur ses joues. Sa toge, tenue par de magnifiques fibules en or, était déchirée par endroits, découvrant ses chevilles jusqu'aux genoux.
Emporté par le courant, je lui tendais désespérément la main lorsqu'elle trébucha ! Sous mes yeux, son corps disparut dans la foule. Craignant qu'elle ne se fît piétiner, je pris mon courage à deux mains et réussis à l'atteindre. Je la saisis, inconsciente dans mes bras.
Nous devions nous mettre rapidement à l’abri du nuage de cendres incandescentes qui dévalait la montagne.
En un éclair, nous fûmes en sécurité dans une taverne creusée à même le sol, la taverne où j’avais l’habitude de me rendre pour y faire la fête avec mes amis. Là, quelques personnes s'étaient déjà réfugiées.
Bientôt, au-dessus de nous, le bruit des pas et les cris de la foule s'évanouirent peu à peu, étouffés par le nuage tueur qui les enveloppait.
Je vis la belle Eilistraée revenir à elle.
« Urcius, que s'est il passé ?, murmura-t-elle.
- Le Vésuve est en éruption, nous courions et tu es tombée, tu étais inconsciente, alors je t'ai portée jusqu'ici.
- Tu... tu m'as sauvé la vie!, dit-elle en m'embrassant. ... Urcius...
- Oui?
- Je t'aime ! » Ses lèvres recouvrirent à nouveau les miennes dans un élan de tendresse.
Emporté par le courant, je lui tendais désespérément la main lorsqu'elle trébucha ! Sous mes yeux, son corps disparut dans la foule. Craignant qu'elle ne se fît piétiner, je pris mon courage à deux mains et réussis à l'atteindre. Je la saisis, inconsciente dans mes bras.
Nous devions nous mettre rapidement à l’abri du nuage de cendres incandescentes qui dévalait la montagne.
En un éclair, nous fûmes en sécurité dans une taverne creusée à même le sol, la taverne où j’avais l’habitude de me rendre pour y faire la fête avec mes amis. Là, quelques personnes s'étaient déjà réfugiées.
Bientôt, au-dessus de nous, le bruit des pas et les cris de la foule s'évanouirent peu à peu, étouffés par le nuage tueur qui les enveloppait.
Je vis la belle Eilistraée revenir à elle.
« Urcius, que s'est il passé ?, murmura-t-elle.
- Le Vésuve est en éruption, nous courions et tu es tombée, tu étais inconsciente, alors je t'ai portée jusqu'ici.
- Tu... tu m'as sauvé la vie!, dit-elle en m'embrassant. ... Urcius...
- Oui?
- Je t'aime ! » Ses lèvres recouvrirent à nouveau les miennes dans un élan de tendresse.
Tout à coup, je fus saisi de tremblements, une force invisible me secouait et une voix provenant du néant s'écria d'un ton sec : « Lorenzo ! Lorenzo ! Réveille-toi ! Reviens parmi nous ! Monsieur Martin, le professeur d'histoire-géographie, me secouait le bras. Alors ? Que t'inspire la vie à l'époque de Pompéi ?, me demanda-t-il.
- DANGEREUSE ! », m'exclamai-je en émergeant brusquement de mon rêve
- DANGEREUSE ! », m'exclamai-je en émergeant brusquement de mon rêve
Niveau 5ème
sujet 1
Laura Morillo,Collège J.Arnolet, St Saulge
Prix spécial du jury
Prix spécial du jury
Dans ce monde qui m'est encore étranger...
Une puissance inconnue me poussa inopinément loin de la chaleur de mon nid. Des larmes écarlates semblaient m'accompagner le long de ce chemin, le moindre de mes pas la faisait crier de douleur... Des cristaux semblaient couler de ses yeux, des diamants des miens lorsque je découvris la lumière.
Une étrange fraîcheur parcourut ma poitrine, un tremblement traversa mes muscles lorsque cet inconnu brisa le lien qui nous soudait depuis des mois me semblant être l'infini...
Je criais cette injustice de toutes mes forces pendant que les diamants s'accumulaient, sans que je ne puisse rien faire.
Des bruits inconnus fusèrent, me bouleversèrent, pendant que toujours et encore, je te cherchais du regard. Ces diamants, très vite, formèrent un océan étincelant de mille feux.
Un musicien passionné semblait jouer du tambour au plus profond de ma poitrine, lorsque tes mains de fées m'enlacèrent...
Un musicien passionné semblait jouer du tambour au plus profond de ma poitrine, lorsque tes mains de fées m'enlacèrent...
Lorsque tes yeux virent les miens, un fil irréel semblait unir nos regards, puis au fil d'un long fleuve, s'élancèrent un a un tes mots chaleureux. Des mots d'un langage rien qu'à nous, d'un langage qui nous est propre... Tes mots qui apaisèrent ce musicien, ton souffle qui stoppa mes tremblements, la chaleur de tes mains qui me donnait confiance, et la douceur de ta peau qui retissa ce lien précédemment brisé.
Ce lien qui transformait cet océan en amour, pendant que les battements de ton cœur, collé à mon oreille, me souhaitaient la bienvenue.
L'inconnu semblant habillé par la neige, les yeux baignés de bienveillance, se mit alors à sourire puis à annoncer d'un ton chaleureux :
« Félicitations... ...c'est une fille ! »
L'inconnu semblant habillé par la neige, les yeux baignés de bienveillance, se mit alors à sourire puis à annoncer d'un ton chaleureux :
« Félicitations... ...c'est une fille ! »
Shin MIGNON, collège Arnolet, Saint Saulge
L'Atlantide
Chère Zoé,
Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus, ma chère sœur...
Depuis mon départ pour l'Atlantique, tu n'as sûrement plus entendu parler de moi. Pourtant je pense à loi tous les jours et j'ai songé bien des fois à t'écrire afin de te donner des nouvelles de ma nouvelle vie. Mais avant que tu comprennes tout, je tiens à m'excuser du fait que tu dois sûrement attendre de mes nouvelles depuis bien longtemps. Hélas, là où je suis, le service de la poste n'existe pas et j'ai dû attendre la migration des hirondelles vers l'Europe ! Et je peux t'assurer que des fois, elles se font attendre. Bref voici mon histoire :
Cela fait si longtemps que nous ne nous sommes pas vus, ma chère sœur...
Depuis mon départ pour l'Atlantique, tu n'as sûrement plus entendu parler de moi. Pourtant je pense à loi tous les jours et j'ai songé bien des fois à t'écrire afin de te donner des nouvelles de ma nouvelle vie. Mais avant que tu comprennes tout, je tiens à m'excuser du fait que tu dois sûrement attendre de mes nouvelles depuis bien longtemps. Hélas, là où je suis, le service de la poste n'existe pas et j'ai dû attendre la migration des hirondelles vers l'Europe ! Et je peux t'assurer que des fois, elles se font attendre. Bref voici mon histoire :
« -Eh, vous là-bas ! !! >>
Un bonhomme en uniforme bleu accourait vers moi ... Que me voulait-il ?
Il semblait sortir de la mer, comme s'il était aussi à l'aise dans l'eau que sur terre. Pourtant, il avait un air familier ; celui des morues du poissonnier, pas toujours très fraîches. Ce personnage comique s'approcha de moi, je m'aperçus que l'odeur était la même que celle du vendeur de poisson. Il me dit:
« -Que faites-vous ici ?? Nos caméras vous ont vu arriver avec votre engin-qui-fait-tourner-sa-tête !
Qu'est ce que c'est ? »
De quoi parlait-il ? De mon hélicoptère ?
«C'est un hélicoptère, répondis-je, docile
- Ce genre de chose n'a rien à faire ici, cependant vous ne pouvez pas repartir, vous en avez déjà trop vu! »
Un bonhomme en uniforme bleu accourait vers moi ... Que me voulait-il ?
Il semblait sortir de la mer, comme s'il était aussi à l'aise dans l'eau que sur terre. Pourtant, il avait un air familier ; celui des morues du poissonnier, pas toujours très fraîches. Ce personnage comique s'approcha de moi, je m'aperçus que l'odeur était la même que celle du vendeur de poisson. Il me dit:
« -Que faites-vous ici ?? Nos caméras vous ont vu arriver avec votre engin-qui-fait-tourner-sa-tête !
Qu'est ce que c'est ? »
De quoi parlait-il ? De mon hélicoptère ?
«C'est un hélicoptère, répondis-je, docile
- Ce genre de chose n'a rien à faire ici, cependant vous ne pouvez pas repartir, vous en avez déjà trop vu! »
La morue me prit par le bras et m'entraîna vers la mer. Paniqué, je m'écriai:
« -Vous êtes fou, nous allons nous noyer ! »
Sans rien dire, l'homme-morue me jeta à l'eau et, m'emprisonna dans une bulle d'air. Il se mit à nager vers le fond de l'océan, il me força à le suivre en m'attachant le poignet à une algue comme un vulgaire chien que l'on traîne en laisse.
« -Je vous emmène dans un endroit qu'aucun être humain n'a jamais visité, un lieu secret, bien décidé à le rester ! »
Je m'aperçus que je pouvais respirer sous l'eau, il était temps !
« -Vous êtes fou, nous allons nous noyer ! »
Sans rien dire, l'homme-morue me jeta à l'eau et, m'emprisonna dans une bulle d'air. Il se mit à nager vers le fond de l'océan, il me força à le suivre en m'attachant le poignet à une algue comme un vulgaire chien que l'on traîne en laisse.
« -Je vous emmène dans un endroit qu'aucun être humain n'a jamais visité, un lieu secret, bien décidé à le rester ! »
Je m'aperçus que je pouvais respirer sous l'eau, il était temps !
Quelques minutes plus tard, nous arrivâmes à l'entrée d'un palais sous-marin. Nous traversâmes un immense jardin aquatique : les rochers étaient couverts d'anémones et le sol était jonché de petites étoiles de mer qui semblaient former un parfait dallage. La morue m'expliqua :
<< -Vous êtes dans la légendaire Atlantide, notre roi a mis au point un système pour effacer la mémoire de ceux qui ont trouvé notre belle cité. Je suis son fidèle serviteur, appelez-moi Balot.
Vous avez le choix ; soit nous effaçons votre mémoire, soit vous servez de repas au prochain banquet ou encore vous devenez l'un des nôtres en passant différentes épreuves. Choisissez....
- Si vous effacez ma mémoire, me souviendrai-je de qui je suis, de mes amis ou de ma famille?
- C'est un des inconvénients de cette technique, personne ne se souvient plus de rien...
-C'est un choix difficile que vous m'offrez là... Cependant je choisis de devenir l'un des vôtres. »
<< -Vous êtes dans la légendaire Atlantide, notre roi a mis au point un système pour effacer la mémoire de ceux qui ont trouvé notre belle cité. Je suis son fidèle serviteur, appelez-moi Balot.
Vous avez le choix ; soit nous effaçons votre mémoire, soit vous servez de repas au prochain banquet ou encore vous devenez l'un des nôtres en passant différentes épreuves. Choisissez....
- Si vous effacez ma mémoire, me souviendrai-je de qui je suis, de mes amis ou de ma famille?
- C'est un des inconvénients de cette technique, personne ne se souvient plus de rien...
-C'est un choix difficile que vous m'offrez là... Cependant je choisis de devenir l'un des vôtres. »
Tu te doutes bien, Zoé, qu'à ce moment même un sentiment de doute germa dans mon esprit ; devrai-je passer docilement les épreuves ou, dès qu'un moment d'inattention surviendrait de la part de mes geôliers, en profiter pour m'enfuir ?
Il m'emmena dans une immense pièce dans l'aile gauche du palais. Là se trouvait une pièce exiguë. Au centre se trouvait un petit tabouret en bois poli sur lequel était assis un bonhomme aussi bizarre que Balot quoique un petit peu plus humain. Pourtant lorsqu'il releva la tête je m'aperçus que ses yeux étaient bandés. Curieux, j'interrogeai le serviteur :
« - Qui est-ce ? Pourquoi a-t-il les yeux bandés ?
- Cet homme est un sorcier ennemi, quiconque le regarde droit dans les yeux... se transforme en pierre... >>
Et il éclata d'un rire odieux. Entre deux souffles il reprit :
« Ton rôle, comme tu dois t'en douter sera de le vaincre. Sois tu penses pouvoir y parvenir, sois tu abandonnes cette épreuve, qui n'est pas obligatoire, et tu devras accomplir mille et une autres tâches plus longues les unes que les autres. Bizarrement c'est ce choix que la plupart des nouveaux arrivants font. Certains y sont encore alors qu'ils sont arrivés il y a bien longtemps, d'autres ont abandonné avant même la 105e épreuve ! Celle du tir à l'arc sur cachalot, si je ne m'abuse... oui c'est cela ! Tiens, pendant que tu réfléchis je vais t'énumérer les différentes épreuves :
Tu dois tout d'abord faire une tarte au requin blanc des fonds marins, très bon avec du miel d'étoiles de mer, pour le roi. Ensuite tu devras réparer les machines à traire les baleines de tous les habitants, puis... >>
« - Qui est-ce ? Pourquoi a-t-il les yeux bandés ?
- Cet homme est un sorcier ennemi, quiconque le regarde droit dans les yeux... se transforme en pierre... >>
Et il éclata d'un rire odieux. Entre deux souffles il reprit :
« Ton rôle, comme tu dois t'en douter sera de le vaincre. Sois tu penses pouvoir y parvenir, sois tu abandonnes cette épreuve, qui n'est pas obligatoire, et tu devras accomplir mille et une autres tâches plus longues les unes que les autres. Bizarrement c'est ce choix que la plupart des nouveaux arrivants font. Certains y sont encore alors qu'ils sont arrivés il y a bien longtemps, d'autres ont abandonné avant même la 105e épreuve ! Celle du tir à l'arc sur cachalot, si je ne m'abuse... oui c'est cela ! Tiens, pendant que tu réfléchis je vais t'énumérer les différentes épreuves :
Tu dois tout d'abord faire une tarte au requin blanc des fonds marins, très bon avec du miel d'étoiles de mer, pour le roi. Ensuite tu devras réparer les machines à traire les baleines de tous les habitants, puis... >>
Au fur et à mesure que Balot énonçait les différentes épreuves, je jetais un coup d'œil par la porte entrouverte : des dizaines de grenouilles s'affairaient à enlever des dizaines de statues en pierre. Au fond de la salle se trouvait un petit miroir à mains et un bâton en bois usé. Soudain, une idée me traversa l'esprit...
« -Balot, je choisis d'affronter ce sorcier!
-Attendez, je n'en étais qu'à l'épreuve de la pieuvre à trente-neuf bras ! Mais si vous insistez, heureux de vous avoir connu! »
Il me fit entrer dans la salle. Avec précaution il retira le bandeau qui couvrait les yeux de mon adversaire et s'enfuit à toutes jambes. L'homme regarda la pièce avant de se tourner vers moi. Avant même que ses yeux ne soient en face des miens, je tombai volontairement à terre et roulai jusqu'au coin de la pièce. Je tentai d'attraper le miroir mais il était comme fixé au sol, je pris le bâton en bois et l'utilisai pour faire levier afin de décoller la glace. Je risquai un coup d'œil par-dessus mon épaule ; le sorcier était encore étourdi, mais il venait de se lever et se dirigeait vers moi, je donnai un grand coup de coude sur le bout de bois et, miraculeusement le miroir se décolla, non sans laisser quelques traces sur le plancher, mais franchement je n'y fis pas attention.
Le sorcier était maintenant à quelques mètres de moi. Sans une once d'hésitation, je plaçai le miroir devant mes yeux, le sorcier me regarda et poussa un cri de terreur. Quelques secondes plus tard, un grand bruit sourd retentit. Abaissant mon bouclier, je vis le sorcier, pétrifié à jamais... Mal à l'aise je rejoignis l'entrée de la pièce. Là Balot m'attendait, les yeux grands ouverts tel une grenouille :
« -Quoi ? J'ai un bouton sur le nez, demandai-je ?
-... Non, tu ... tu viens de terrasser le plus terrible des sorciers
sous-marins... je me permets de te tutoyer, tu n'es plus un étranger ... mais un ami !
- Merci, mais à croire que tout était prévu ; le miroir collé sur le sol, le bâton qui était juste assez robuste pour faire levier...
Tu ne trouves pas ça un peu bizarre ?
- Pour tout te dire, c'était une épreuve réservée aux traîtres. Il y a des millions d'années, le roi, à cette époque, était le seul à connaître le stratagème, et puis un jour, un de ses conseillers qui convoitait le trône, réussit à lui arracher le secret et mit au courant tous les traîtres qui étaient déjà en prison et qui devaient « comparaître >> devant le sorcier. Bien sûr, ces derniers se rebellèrent et ce fut la fin de Saulomon XVI. » Il avait parlé avec la même voix qu'un professeur d'histoire qui fait sa leçon en racontant comme s'il avait vécu la scène... J'ai trouvé cela amusant…
Peu de temps après, mon nouvel ami, m'emmena auprès du roi, où se déroula une multitude de cérémonies en mon honneur. Je fus soulevé, plongé dans de l'huile et dans du vinaigre. Soit dit en passant, je ne vois toujours pas comment il les faisait tenir dans leur récipient avec toute l’eau qui trainait autour. Tout en leur répétant que je n'étais pas une salade, ils m'emmenèrent dans une immense salle de bal. Au fond, il y avait une grande table où siégeaient le roi et sa famille :
« -Asseyez-vous ! m'ordonna le souverain »
Sans discuter davantage, je m'installai sur une chaise en bois ciré. Un esclave me servit du poisson et une salade d'étoiles de mer. Le roi m'expliqua :
« -Ton jeune esprit doit être empli de doute ; tu te demandes si tu es capable de passer ta vie dans la même cité que des hommes-poissons. Tu voudrais savoir si tu peux prévenir ta famille, et peut être aussi ce qui a pu arriver à notre ville et à ses habitants pour qu'elle devienne ce qu'elle est. N'est-ce pas?
- Je vois que sa Majesté ne se contente pas d'effacer la mémoire, vous lisez également dans l'esprit des autres, n'est-ce pas ? M'efforçai-je de dire avec mon plus beau sourire.
- Non, jeune héros, toutes les émotions se lisent dans tes yeux. Maintenant que tu as battu le sorcier, j'ai réfléchi ; certes je vieillis de jour en jour, mais je gagne également en sagesse, j'ai décidé de révéler la présence de l'Atlantide au monde d'en haut ! >>
Une immense vague de surprise traversa l'assemblée avant de se transformer en cris de joie !
Sans discuter davantage, je m'installai sur une chaise en bois ciré. Un esclave me servit du poisson et une salade d'étoiles de mer. Le roi m'expliqua :
« -Ton jeune esprit doit être empli de doute ; tu te demandes si tu es capable de passer ta vie dans la même cité que des hommes-poissons. Tu voudrais savoir si tu peux prévenir ta famille, et peut être aussi ce qui a pu arriver à notre ville et à ses habitants pour qu'elle devienne ce qu'elle est. N'est-ce pas?
- Je vois que sa Majesté ne se contente pas d'effacer la mémoire, vous lisez également dans l'esprit des autres, n'est-ce pas ? M'efforçai-je de dire avec mon plus beau sourire.
- Non, jeune héros, toutes les émotions se lisent dans tes yeux. Maintenant que tu as battu le sorcier, j'ai réfléchi ; certes je vieillis de jour en jour, mais je gagne également en sagesse, j'ai décidé de révéler la présence de l'Atlantide au monde d'en haut ! >>
Une immense vague de surprise traversa l'assemblée avant de se transformer en cris de joie !
Tu te doutes bien qu'après les aveux du roi, tu peux te précipiter dans le journal le plus proche afin de transmettre la nouvelle ; tout repose sur tes épaules, tu peux choisir de tout révéler comme tu peux décider d'en faire un secret de famille.
Après ce festival de joie, vinrent enfin les présentations, que je te résume ; comme tu le sais je suis ton frère et je m'appelle Bastien. Le roi se nomme Sardine à l’huile 1 et sa fille, la plus belle femme du monde, se prénomme Clio.
Après ce festival de joie, vinrent enfin les présentations, que je te résume ; comme tu le sais je suis ton frère et je m'appelle Bastien. Le roi se nomme Sardine à l’huile 1 et sa fille, la plus belle femme du monde, se prénomme Clio.
Après le banquet, Clio me montra mes appartements, et lorsque nous fûmes sur le balcon, je lui pris ses mains et la suppliai de m'épouser... elle accepta, et son père nous maria un jour d'été .
J'eus vite abandonné l'idée de remonter à la surface, pour la simple et bonne raison qu'en permanence tournoyaient des requins à la surface de l'eau.
Le roi me confia un petit travail : inventer des énigmes pour les nouveaux arrivants.
Zoé, cette vie me plaît mais vous me manquez ; toi, maman et papa ainsi que tes rejetons ... J'ai demandé au roi la permission de vous faire venir ici dès que vous le souhaitez. Vous trouverez des combinaisons sous le troisième rocher en partant du bout de la plage, ensuite vous n'aurez qu'à plongez en regardant vers le sud ouest ... Ne t'en fais pas pour les requins ; tu n'as qu'à m'envoyer par pigeon la date de ton arrivée à l'adresse qui suit, j'aurai vite fait de leur organiser une partie de pêche à quelques lieues de la ville.
Le roi me confia un petit travail : inventer des énigmes pour les nouveaux arrivants.
Zoé, cette vie me plaît mais vous me manquez ; toi, maman et papa ainsi que tes rejetons ... J'ai demandé au roi la permission de vous faire venir ici dès que vous le souhaitez. Vous trouverez des combinaisons sous le troisième rocher en partant du bout de la plage, ensuite vous n'aurez qu'à plongez en regardant vers le sud ouest ... Ne t'en fais pas pour les requins ; tu n'as qu'à m'envoyer par pigeon la date de ton arrivée à l'adresse qui suit, j'aurai vite fait de leur organiser une partie de pêche à quelques lieues de la ville.
A bientôt
Bastien
20000 lieues sous les mers
1178 Rue du l'étoile, Atlantide
Sujet 2
Charlotte VIDAL, Collège J.Moulin, Marcigny
Un aventurier pas comme les autres
Enfermée dans ma chambre. Rien à faire. S'ennuyer. Voilà la description de mon quotidien. C'est tellement ennuyant que je commence à être contente d'écouter qu'il y a un but marqué par Zlatan (même si je le hais). Ça devient inquiétant... surtout pour moi.
Je n'ai jamais aimé le foot (t'as vu le pognon qu'il gagne ? Juste pour s'amuser et taper dans un ballon...) ni tous les sports d'ailleurs. Alors toi qui lis ces lignes, arrêtes-toi tout de suite !
Tu vois, mon quotidien est ennuyant, il ne se passe rien et il ne se passera jamais rien ! En même temps, une fille de treize ans qui s'appelle Lou (oui, je sais. comme la bande dessinée LOU!) et qui rêve de partir, de bouger et d'être libre ne sera jamais satisfaite quand elle vit à la campagne, au fin fond de la campagne. Ah, quelle vie pourrie !
Bon, un peu de musique remonte toujours le moral ! Le poste allumé, je m'allongeais sur mon lit. La musique allait arriver mais en attendant, il y avait un reportage sur la forêt tropicale. La forêt tropicale…
J'écoutais attentivement. La forêt tropicale... grande, verte, merveilleuse. Tant d'explorateurs ont été dans cet endroit, plein de mystères et de dangers. L'aventure, le risque, la découverte ! Tout ce dont je rêve !
Je ferme les yeux et, comme emportée par un souffle magique, je pars...
Des grands arbres verts me taisaient face. J'entendais le bruit des singes qui sautaient d'arbre en arbre, les oiseaux multicolores qui volent dans le ciel écarlate. J'apercevais des fleurs magnifiques de toutes les couleurs et de toutes les formes, des arbres gigantesques qui ont vu tant de choses dans cette immense forêt. La forêt tropicale !
C'était… magnifique ! Les fleurs mettaient de la couleur dans la dense végétation verte. Des arbres gigantesques formaient la canopée de la forêt où vivent les singes. J'entendais leurs cris venant du haut des arbres et je les voyais sautant de branche en branche. On aurait presque dit qu'ils volaient Comme leurs voisins les perroquets aux ailes multicolores qui semblent luire en plein soleil. Et les immenses pythons colorés enroulés aux branches cherchant des proies. Qu'est ce qu'ils étaient beaux ! Sur le sol, les grenouilles rouges ou bleu fluo ou même jaunes bondissaient en montrant leurs belles rayures noires. Tous étaient magiques et semblaient sortir d'un conte de fée !
J'aurais pu rester là des heures si une bande de sauvages ne m'étaient pas tomber dessus : vêtus de plumes colorées, ils ont pointé du doigt. J’eus alors un réflexe de trouillard : je m'enfuyais à toute vitesse. C'était beaucoup plus physique que les cours de sport. Obstacles, animaux, plantes... il y en avait des choses qui m'ont ralenti dans ma course dans la forêt.
Après une longue course, je débouchais enfin sur… punaise quelle chanceuse je fais ! Je débouchais sur un immense fleuve où se côtoyaient alligators et piranhas. Bon et là, je fais comment? Il n'y avait pas de chemin ni à ma droite, ni à ma gauche. J'étais bloqué !
- Pitié, pensais-je en moi. lndiana Jones, Tarzan ! Venez me sauver !
J'attendais quelques instants pour voir si ils venaient. Le cri des indiens retentit dans la forêt Bon, puisque ni Tarzan, ni Indiana Jones ne venait, il ne restait plus qu'une solution : sauter ! J'allais le faire que les indiens m'avaient déjà rattrapée : trop tard
Ils me ligotèrent puis m'emmenèrent jusqu'à leur village qui, comme ma maison, est perdu dans un coin au fin fond de la forêt. Le village est minuscule, les cabanes horribles. La pièce unique à l'intérieur n'est pas plus grande qu'une salle à manger. (bon, toutes les salles à manger ne font pas la même taille mais je veux juste montrer que c’est minuscule.)
Ils me conduisirent devant un gros homme (sûrement leurs chef car il avait un grand bâton en main). Le chef me regarda et se lécha les babines ! Non, j'étais dans une tribu de cannibales ! Le chef pointa du doigt une case où les indiens mc conduisirent.
La case était éclairée par un feu au centre et un grand totem contre le mur. On me fit asseoir devant le feu. De l’autre côté du feu et en face de moi se tenait un vieil homme masqué aux longs cheveux bancs. Ce devait être le sorcier. Ce jeune homme me regarda puis se tourna vers le totem en se mettant à genoux. Il resta ainsi pendant une demi-heure puis il se retourna et saisit un poignard. Non, il allait me découper en rondelles comme du saucisson !
- Au secours ! A l'aide ! criais-je de toutes mes forces. Indiana Jones ! Tarzan ! S.O.S. ! Je veux pas servir de pâture à des cannibales!
Le sorcier levait son poignard. Je fermais les yeux, prête à sentir sa lame me transpercer.
Je n'ai jamais aimé le foot (t'as vu le pognon qu'il gagne ? Juste pour s'amuser et taper dans un ballon...) ni tous les sports d'ailleurs. Alors toi qui lis ces lignes, arrêtes-toi tout de suite !
Tu vois, mon quotidien est ennuyant, il ne se passe rien et il ne se passera jamais rien ! En même temps, une fille de treize ans qui s'appelle Lou (oui, je sais. comme la bande dessinée LOU!) et qui rêve de partir, de bouger et d'être libre ne sera jamais satisfaite quand elle vit à la campagne, au fin fond de la campagne. Ah, quelle vie pourrie !
Bon, un peu de musique remonte toujours le moral ! Le poste allumé, je m'allongeais sur mon lit. La musique allait arriver mais en attendant, il y avait un reportage sur la forêt tropicale. La forêt tropicale…
J'écoutais attentivement. La forêt tropicale... grande, verte, merveilleuse. Tant d'explorateurs ont été dans cet endroit, plein de mystères et de dangers. L'aventure, le risque, la découverte ! Tout ce dont je rêve !
Je ferme les yeux et, comme emportée par un souffle magique, je pars...
Des grands arbres verts me taisaient face. J'entendais le bruit des singes qui sautaient d'arbre en arbre, les oiseaux multicolores qui volent dans le ciel écarlate. J'apercevais des fleurs magnifiques de toutes les couleurs et de toutes les formes, des arbres gigantesques qui ont vu tant de choses dans cette immense forêt. La forêt tropicale !
C'était… magnifique ! Les fleurs mettaient de la couleur dans la dense végétation verte. Des arbres gigantesques formaient la canopée de la forêt où vivent les singes. J'entendais leurs cris venant du haut des arbres et je les voyais sautant de branche en branche. On aurait presque dit qu'ils volaient Comme leurs voisins les perroquets aux ailes multicolores qui semblent luire en plein soleil. Et les immenses pythons colorés enroulés aux branches cherchant des proies. Qu'est ce qu'ils étaient beaux ! Sur le sol, les grenouilles rouges ou bleu fluo ou même jaunes bondissaient en montrant leurs belles rayures noires. Tous étaient magiques et semblaient sortir d'un conte de fée !
J'aurais pu rester là des heures si une bande de sauvages ne m'étaient pas tomber dessus : vêtus de plumes colorées, ils ont pointé du doigt. J’eus alors un réflexe de trouillard : je m'enfuyais à toute vitesse. C'était beaucoup plus physique que les cours de sport. Obstacles, animaux, plantes... il y en avait des choses qui m'ont ralenti dans ma course dans la forêt.
Après une longue course, je débouchais enfin sur… punaise quelle chanceuse je fais ! Je débouchais sur un immense fleuve où se côtoyaient alligators et piranhas. Bon et là, je fais comment? Il n'y avait pas de chemin ni à ma droite, ni à ma gauche. J'étais bloqué !
- Pitié, pensais-je en moi. lndiana Jones, Tarzan ! Venez me sauver !
J'attendais quelques instants pour voir si ils venaient. Le cri des indiens retentit dans la forêt Bon, puisque ni Tarzan, ni Indiana Jones ne venait, il ne restait plus qu'une solution : sauter ! J'allais le faire que les indiens m'avaient déjà rattrapée : trop tard
Ils me ligotèrent puis m'emmenèrent jusqu'à leur village qui, comme ma maison, est perdu dans un coin au fin fond de la forêt. Le village est minuscule, les cabanes horribles. La pièce unique à l'intérieur n'est pas plus grande qu'une salle à manger. (bon, toutes les salles à manger ne font pas la même taille mais je veux juste montrer que c’est minuscule.)
Ils me conduisirent devant un gros homme (sûrement leurs chef car il avait un grand bâton en main). Le chef me regarda et se lécha les babines ! Non, j'étais dans une tribu de cannibales ! Le chef pointa du doigt une case où les indiens mc conduisirent.
La case était éclairée par un feu au centre et un grand totem contre le mur. On me fit asseoir devant le feu. De l’autre côté du feu et en face de moi se tenait un vieil homme masqué aux longs cheveux bancs. Ce devait être le sorcier. Ce jeune homme me regarda puis se tourna vers le totem en se mettant à genoux. Il resta ainsi pendant une demi-heure puis il se retourna et saisit un poignard. Non, il allait me découper en rondelles comme du saucisson !
- Au secours ! A l'aide ! criais-je de toutes mes forces. Indiana Jones ! Tarzan ! S.O.S. ! Je veux pas servir de pâture à des cannibales!
Le sorcier levait son poignard. Je fermais les yeux, prête à sentir sa lame me transpercer.
- Chérie ! Calme-toi ! Réveille-toi !
J'ouvrais les yeux. J'étais sur mon lit dans ma chambre, ma mère à mes côtés.
- Lou ! Ça fait une heure que tu cries comme ça ! Je croyais que quelqu'un allait te poignarder !
C'est ce qui était à deux doigts de s'être produit. Oh punaise ! Enfin au calme.
- Ah ! Ça fait du bien d'être à la campagne au calme…
Ma mère m'a regardé comme si j'étais une folle.
-Ça va Lou ? Tu te sens bien ? Tu détestes la campagne jusqu'aux bouts des orteils et tu viens de me dire que ça fait du bien d'être au calme à la campagne ???
-Ouais ! Quand tu viens de rentrer de la forêt tropicale, de te faire pourchasser par des indiens, de te faire capturer par eux, découvrir que ce sont des indiens cannibales et manquer de se faire poignarder par leur sorcier qui veut te découper en tranches de saucisson pour l’apéro, oui, tu adores la tranquillité de la campagne !
Maman m'a regardé, a souri puis a éclaté de rire.
A près ce petit rêve, quelques petites choses ont changé dans ma vie :
- je prends des cours de karaté (on sait jamais, si des indiens m'attaquent)
- je prends des cours de course à pied (on sait jamais, s'ils me poursuivent encore dans la forêt)
- je me documente sur la forêt tropicale (on sait jamais,si j'y retourne pour de vrai, il faudrait que je sois préparée mieux que ça !).
J'ouvrais les yeux. J'étais sur mon lit dans ma chambre, ma mère à mes côtés.
- Lou ! Ça fait une heure que tu cries comme ça ! Je croyais que quelqu'un allait te poignarder !
C'est ce qui était à deux doigts de s'être produit. Oh punaise ! Enfin au calme.
- Ah ! Ça fait du bien d'être à la campagne au calme…
Ma mère m'a regardé comme si j'étais une folle.
-Ça va Lou ? Tu te sens bien ? Tu détestes la campagne jusqu'aux bouts des orteils et tu viens de me dire que ça fait du bien d'être au calme à la campagne ???
-Ouais ! Quand tu viens de rentrer de la forêt tropicale, de te faire pourchasser par des indiens, de te faire capturer par eux, découvrir que ce sont des indiens cannibales et manquer de se faire poignarder par leur sorcier qui veut te découper en tranches de saucisson pour l’apéro, oui, tu adores la tranquillité de la campagne !
Maman m'a regardé, a souri puis a éclaté de rire.
A près ce petit rêve, quelques petites choses ont changé dans ma vie :
- je prends des cours de karaté (on sait jamais, si des indiens m'attaquent)
- je prends des cours de course à pied (on sait jamais, s'ils me poursuivent encore dans la forêt)
- je me documente sur la forêt tropicale (on sait jamais,si j'y retourne pour de vrai, il faudrait que je sois préparée mieux que ça !).
Je ne sais pas encore quel métier je veux faire, mais quand je serais assez grande, je partirais dans la forêt tropicale. Parce que c'est bien d'y aller en rêve, car on n'est sûr de ne pas mourir, mais pour de vrai, qu'est ce que ça doit être beau !
Si un jour je pars là-bas, je vous promets de vous le raconter. Pour vous donner envie d'y aller et de voir par vous même tout ce que j'aurais vu…
Si un jour je pars là-bas, je vous promets de vous le raconter. Pour vous donner envie d'y aller et de voir par vous même tout ce que j'aurais vu…
Niveau 4ème
Sujet 1
Aubin GADY, collège du Vallon, Autun
Aventures à Versailles
Versailles, le 12 août 1776
Chère amie,
Ne me blâmez pas de ne point vous avoir écrit plus tôt. J'en suis fort marri. D’incroyables aventures me sont arrivées et le dénouement en a été tellement extraordinaire que moi-même je n'ose y croire.
Comme vous le savez, je me rendais en voiture à St Germain, pour discuter avec des gens de lettres au café Procope. Depuis peu, des philosophes répandent des idées nouvelles, quelque peu révolutionnaires, mais qui sont très intéressantes. Mon cocher avait pris un petit chemin et tentait de rattraper le retard que j'avais eu à cause d'une altercation avec une autre voiture, qui avait accidentellement rayé ma berline. Nous nous engagions dans un passage très resserré lorsqu'une douzaine d'hommes se précipita devant la voiture, ne laissant aucune issue possible. Je dégainai alors mon fleuret et sautai hors de la berline. A l'allure qu'avaient mes adversaires, je compris que c'étaient des bandits qui n'avaient qu'une pratique de l'escrime très rudimentaire. Je me mis en garde et me dirigeai vers celui qui semblait être le chef. Il avait une carrure impressionnante et sa mine patibulaire, avec sa balafre sur son œil gauche, ses dents gâtées et ses sourcils très épais, m'impressionnèrent. Je me mis en position de tierce et commençai par un enchaînement de feintes dans le seul but de jauger mon adversaire. Celui-ci fut d'abord déstabilisé un court instant puis il débuta le combat. Je remarquai vite que, quand il feintait, il m'exposait son flanc gauche. Je l'attaquai d'abord à l'aide d'une feinte, puis évitai de justesse un coup en pivotant légèrement. Je terminai par une de mes bottes favorites et le touchai. La blessure n'était pas grave mais le mit hors de combat. Je me tournai alors vers un autre bretteur et 1'écartai rapidement. Mais je compris que, malgré ma science des armes, ces bandits triompheraient sans mal, grâce à leur nombre. Je me décidai à prendre la fuite et me mis à courir. Quelques-uns de mes adversaires me suivirent. J'arrivai dans une petite bourgade et, au détour d'une rue, j'avisai une diligence. A l'arrière, une malle était sanglée et lorsque j'entendis les pas de mes poursuivants, je me glissai dedans. Je me cachai à l'intérieur en prenant soin de bien la refermer et me résolus à attendre. A ma grande surprise, la voiture se mit en route, d'abord lentement puis elle accéléra. J'étais cahoté et ma position n'était pas extrêmement confortable. Je ne saurais dire combien de temps dura le trajet car je n'apercevais nullement l'extérieur. Lorsqu'enfin la voiture ralentit, je pris conscience de ma situation. J'étais dans une malle fixée sur une diligence ; je n'avais aucune idée de l'endroit où je pouvais être et enfin, personne ne savait où j'étais. Quand la voiture fut totalement arrêtée, je risquai un œil hors de la malle. J'étais dans une immense écurie : un palefrenier déchargeait du foin pour les étalons et nettoyait la litière des bêtes. Je sortis discrètement par une petite porte cochère. Un immense palais s'étendait, barrant l'horizon de sa silhouette constellée d'innombrables fenêtres. Je compris alors que j'étais au château de Versailles, dont j'avais entendu maintes fois des louanges sur la magnificence de la décoration. Je décidai de rentrer dans le château et me dirigeai vers la grille en fer forgée, ornementée de décorations recouvertes d'or. Quelques gardes étaient postés à la grille et jouaient aux cartes. Ils laissèrent passer sans problème et je m'avançai vers le château. L'après-midi était assez chaud et malgré la température, de nombreux courtisans se pavanaient devant le château et ses belles. Celui-ci possédait deux ailes identiques, un peu en retrait par rapport au corps principal. Le toit était recouvert de tuiles et des dorures l'agrémentaient. Des fenêtres indénombrables venaient percer la façade du palais. J'entrai par l'une des portes ouvertes et découvris un salon dans lequel un groupe de courtisans écoutait une pièce jouée par plusieurs cors de chasse. Je ne m'attardai pas dans la pièce et passai à la suivante. C'était un petit salon où quelques personnes, assises dans des fauteuils, conversaient. A mon arrivée, je les saluai et elles firent de même. Je continuai ma visite et arrivai dans un corridor : deux domestiques nettoyaient le sol. J'empruntai ce couloir et débouchai sur une grande esplanade située derrière le château. Je fus stupéfait par les jardins et les bassins qui s'étendaient à longueur de vue. Plusieurs bassins, avec en leurs centres des statues dorées, s'étendaient au milieu des jardins. De chaque côté, des parterres soigneusement taillés encadraient des allées permettant d'accéder aux différents jardins, fontaines et labyrinthes. Je descendis les quelques marches de la terrasse qui me séparaient des allées. De belles courtisanes se promenaient, toutes plus somptueuses les unes que les autres. Leurs coiffures étaient extravagantes, leurs visages étaient couverts de maquillage et leurs parures, pour certaines de perles et pour d'autres de pierres précieuses, étincelaient sous le soleil. Des jardiniers replantaient, désherbaient, arrosaient et taillaient les massifs qui s'étalaient au sol. D'autres s'occupaient des fontaines et des bassins. Quelques hommes partaient pour la chasse, accompagnés de lévriers et de sonneurs.
Je me dirigeai alors vers un laquais et lui demandai où se trouvait le bureau de l'intendant. Il consentit à m'accompagner à son bureau et je le suivis à travers une enfilade de couloirs et de pièces. Je frappai à la porte et une voix m'autorisa à rentrer. La pièce était vaste et fastueuse : des tapisseries pendaient au mur et des grands fauteuils de velours étaient disposés de part et d'autre du bureau. L'intendant du palais était un homme assez âgé et, malgré sa stature imposante, il semblait juste et loyal. Je m'informai s'il n'y avait pas au château un travail pour moi. L'intendant me répondit qu'une place était vacante dans la garde royale : j'acceptai la place, après l'avoir remercié.
Je me dirigeai vers la salle des gardes et endossai mon nouvel uniforme : je ne m'attarderai pas sur sa description. De l'autre côté de la pièce, des hommes à l'allure patibulaire discutaient. Je m'assis à une table proche de la leur et tendis l'oreille pour comprendre ce qu'ils disaient. Je fus horrifié par leur conversation : je compris qu'ils fomentaient un complot contre un capitaine de la garde. Ils voulaient lui tendre une embuscade et faire disparaître son corps dans un des nombreux bassins. Leur plan se déroulerait vers le hameau de la reine, à la tombée de la nuit, lorsque le capitaine rentrerait de sa garde. Il avait pour but de remplacer le capitaine par un des hommes.
Je décidai de faire quelque chose pour le capitaine mais je n'avais aucun soutien. Je ne pouvais compter que sur moi-même. J'allai dans ma chambre, sous les combles, et me vêtit entièrement de noir. Je pris la précaution de mettre un gilet de buffle pour me protéger des coups et cachai une dague dans ma large botte. Ainsi vêtu, je me dirigeai vers le hameau de la reine, cette ferme construite pour la reine, en plein milieu du parc, recréant un décor champêtre. La reine y séjournait de temps en temps, pour se distraire. Je me cachai, allongé dans un massif à proximité du hameau et attendit patiemment. Je vis d'abord une lumière, qui appartenait sans doute à une ronde. Puis, un homme de constitution robuste s'avança seul le long de l'allée qui reliait la ferme au château. Aussitôt, trois hommes lui sautèrent dessus. Sans plus attendre, je bondis et engageai le combat, accompagné du capitaine. Un des hommes, sous le coup de la surprise, n'eut pas le temps de réagir : je le désarmai, lui portai un coup sous l'omoplate et le jetai par terre. Les deux autres bretteurs avaient engagé le combat avec le capitaine et j'en attirai un vers moi. Le combat ne fut ni difficile, ni long et l'homme se retrouva rapidement au sol. Le troisième, effrayé, s'enfuit dans la nuit et je ne sais ce qu'il en advint. Le capitaine courut chercher la garde, pendant que je surveillais les prisonniers. Quelques heures plus tard, les deux hommes étaient dans des geôles, pendant que le capitaine me congratulait. Le lendemain, il me présenta au Roi et Sa Majesté me fit chevalier pour ma bravoure. Depuis, je suis aide de camp du capitaine.
Chère amie, voudriez-vous me rejoindre à Versailles? Le capitaine m'a proposé de s’arranger pour nous trouver une chambre. Ce serait merveilleux de séjourner à la cour de notre bien-aimé Roi. Je vous attends impatiemment et espère vous retrouver sous peu.
Je suis votre serviteur,
Chevalier Viauney de Maintcourt
Chevalier Viauney de Maintcourt
sujet 2, prix « prose »
Aliénor DELPOUVE, collège Jean Vilar, Châlon sur Saône
Moi, Lorenza, fille du Cirque Della Luna
Aux alentours de Florence, Italie
Emplacement du cirque Della Luna
Emplacement du cirque Della Luna
« - Lorenza ! »
Je me retournai, mes longs cheveux bruns bouclés fouettant le vent, curieuse de savoir qui m'interpellait ainsi. Je souris, fixant mes yeux vert pomme pailletés d'or sur mon meilleur ami, Lorenzo De Luca, essoufflé après sa course, suivi de près par Tic et Tac, les deux chiens que mon magicien préféré, Vasco Volpino, utilisait pour certains de ses tours.
« Tes parents sont en train de te chercher partout », m'informa Lorenzo, ses yeux bleu-gris en amande pétillant après son effort. Et il ajouta, pour me taquiner : « Je suppose que tu n'as pas oublié que ce soir, on participera à la représentation, mais que l'on n'est pas dispensés pour autant d'aider à l'installation du cirque ! » Mon visage se fendit d'un immense sourire. J'adorais aider à installer le cirque avec les autres membres de la troupe.
« - Alors je te suis ! Tu crois que Nico, Carlos et Pietro sont déjà allés en ville annoncer notre arrivée ? , m'exclamai-je.
- J'en suis sûr, me répondit-il. Allons-y, sinon on va se faire gronder par nos parents ! »
Arrivés sur place, nous découvrîmes le chapiteau déjà monté, et Benvenuto Ozzello, le dompteur, nous fit signe de venir.
« Alors, c'est comme ça que l'on aide à monter le chapiteau ? Allez, filez avant que vos parents ne vous voient, vous passent un savon et reviennent sur leur décision de vous faire participer à la représentation, rouspéta-t-il avec bienveillance. Au fait Lorenza, Viola et Violetta veulent te voir pour répéter le spectacle de ce soir. Et toi aussi Lorenzo, ton père et Tania te cherchent. Je vous conseille de vous dépêcher ! »
Lorenzo et moi remerciâmes Benvenuto, et nous nous hâtâmes de rejoindre nos instructeurs respectifs. Au cirque Della Luna, où je suis née, la troupe est composée du dompteur, Benvenuto Ozzello, des deux écuyères Viola et Violetta Bartolozzi, qui m'ont prise comme apprentie. Il y a Silvio De Luca qui est le père de Lorenzo. Il est trapéziste. Ma mère, Tania Lombardi, est sa partenaire, et il a pris son fils comme apprenti. Dans la famille De Luca, on est trapéziste de père en fils ! Sa femme, Zaïra De Luca, est la voyante du cirque. D'après moi, elle ne dit que des boniments, mais chut... Carlos Calabro et Pietro Pambianchi sont les clowns du cirque, et mon petit frère, Cesare, prend exemple sur eux pour tout ce qu'il fait. Cela devient vite agaçant ! Quand je pense qu'il n'a que quatre ans ! Il y a aussi le magicien de la troupe, Vasco Volpino, que j'apprécie particulièrement car il est très jeune : il aura 20 ans le mois prochain ! L'acrobate de la troupe, c'est mon père, Falco Lombardi. C'est un peu l'oncle de tout le monde ici : c'est un vrai papa gâteau et il est toujours de bonne humeur. Et pour finir, il y a celui que tout le monde surnomme affectueusement "nonno" (grand-père, en italien), c'est le monsieur Loyal de notre troupe et le directeur du cirque, j'ai nommé... Nico Monaci ! Il nous répète toujours quand on râle pour recommencer quelque chose : « Recommencer est un verbe que l'on doit savoir à tous les temps pour pouvoir éblouir et fasciner le public ! ». On a tous fini par connaître cette phrase par cœur ! Et puis, pour finir les présentations, il y a moi. Je m'appelle Lorenza, qui signifie « couronnée de laurier » en latin. J'ai 12 ans. Je suis audacieuse, réfléchie et j'adore les chevaux. C'est pour cela que j'ai décidé de devenir écuyère. Ici, au cirque, tout le monde voulait devenir clown, acrobate ou équilibriste quand ils étaient petits, et tous ont réalisé leur rêve : c'est ça, la magie du cirque.
Ce soir, Lorenzo et moi allons participer à notre premier spectacle, voilà pourquoi tout le monde nous cherche : on doit répéter en costume aujourd'hui. Mon costume à moi, c'est un tutu doré avec des paillettes et le diadème qui a appartenu à la petite sœur des jumelles Viola et Violetta. Elle s'appelait Véra. Elle était acrobate mais un numéro qu'elle avait monté a mal tourné, il y a de ça cinq ans. Elle est décédée peu de temps après de ses blessures. C'est le plus gros deuil du cirque depuis que Nico en est le directeur. Mon père a été très affecté par sa mort : Véra avait été son élève. Il en avait perdu sa bonne humeur ! Maintenant, tous les regards du cirque sont braqués sur Lorenzo et moi. Tout le monde espère tellement que l'on réussisse notre numéro ! Nous aussi, d'ailleurs. Lorenzo est sûr de le réussir. Je l'envie, car moi, j'ai peur de tomber de Perlita, la jument avec laquelle je travaille, ou de rater une de mes pirouettes. La honte que cela serait pour le cirque et pour moi ! Je n'ose même pas l'imaginer. Mais je suis tenu de rejoindre les jumelles : elles doivent m'attendre avec impatience pour répéter.
Je me retournai, mes longs cheveux bruns bouclés fouettant le vent, curieuse de savoir qui m'interpellait ainsi. Je souris, fixant mes yeux vert pomme pailletés d'or sur mon meilleur ami, Lorenzo De Luca, essoufflé après sa course, suivi de près par Tic et Tac, les deux chiens que mon magicien préféré, Vasco Volpino, utilisait pour certains de ses tours.
« Tes parents sont en train de te chercher partout », m'informa Lorenzo, ses yeux bleu-gris en amande pétillant après son effort. Et il ajouta, pour me taquiner : « Je suppose que tu n'as pas oublié que ce soir, on participera à la représentation, mais que l'on n'est pas dispensés pour autant d'aider à l'installation du cirque ! » Mon visage se fendit d'un immense sourire. J'adorais aider à installer le cirque avec les autres membres de la troupe.
« - Alors je te suis ! Tu crois que Nico, Carlos et Pietro sont déjà allés en ville annoncer notre arrivée ? , m'exclamai-je.
- J'en suis sûr, me répondit-il. Allons-y, sinon on va se faire gronder par nos parents ! »
Arrivés sur place, nous découvrîmes le chapiteau déjà monté, et Benvenuto Ozzello, le dompteur, nous fit signe de venir.
« Alors, c'est comme ça que l'on aide à monter le chapiteau ? Allez, filez avant que vos parents ne vous voient, vous passent un savon et reviennent sur leur décision de vous faire participer à la représentation, rouspéta-t-il avec bienveillance. Au fait Lorenza, Viola et Violetta veulent te voir pour répéter le spectacle de ce soir. Et toi aussi Lorenzo, ton père et Tania te cherchent. Je vous conseille de vous dépêcher ! »
Lorenzo et moi remerciâmes Benvenuto, et nous nous hâtâmes de rejoindre nos instructeurs respectifs. Au cirque Della Luna, où je suis née, la troupe est composée du dompteur, Benvenuto Ozzello, des deux écuyères Viola et Violetta Bartolozzi, qui m'ont prise comme apprentie. Il y a Silvio De Luca qui est le père de Lorenzo. Il est trapéziste. Ma mère, Tania Lombardi, est sa partenaire, et il a pris son fils comme apprenti. Dans la famille De Luca, on est trapéziste de père en fils ! Sa femme, Zaïra De Luca, est la voyante du cirque. D'après moi, elle ne dit que des boniments, mais chut... Carlos Calabro et Pietro Pambianchi sont les clowns du cirque, et mon petit frère, Cesare, prend exemple sur eux pour tout ce qu'il fait. Cela devient vite agaçant ! Quand je pense qu'il n'a que quatre ans ! Il y a aussi le magicien de la troupe, Vasco Volpino, que j'apprécie particulièrement car il est très jeune : il aura 20 ans le mois prochain ! L'acrobate de la troupe, c'est mon père, Falco Lombardi. C'est un peu l'oncle de tout le monde ici : c'est un vrai papa gâteau et il est toujours de bonne humeur. Et pour finir, il y a celui que tout le monde surnomme affectueusement "nonno" (grand-père, en italien), c'est le monsieur Loyal de notre troupe et le directeur du cirque, j'ai nommé... Nico Monaci ! Il nous répète toujours quand on râle pour recommencer quelque chose : « Recommencer est un verbe que l'on doit savoir à tous les temps pour pouvoir éblouir et fasciner le public ! ». On a tous fini par connaître cette phrase par cœur ! Et puis, pour finir les présentations, il y a moi. Je m'appelle Lorenza, qui signifie « couronnée de laurier » en latin. J'ai 12 ans. Je suis audacieuse, réfléchie et j'adore les chevaux. C'est pour cela que j'ai décidé de devenir écuyère. Ici, au cirque, tout le monde voulait devenir clown, acrobate ou équilibriste quand ils étaient petits, et tous ont réalisé leur rêve : c'est ça, la magie du cirque.
Ce soir, Lorenzo et moi allons participer à notre premier spectacle, voilà pourquoi tout le monde nous cherche : on doit répéter en costume aujourd'hui. Mon costume à moi, c'est un tutu doré avec des paillettes et le diadème qui a appartenu à la petite sœur des jumelles Viola et Violetta. Elle s'appelait Véra. Elle était acrobate mais un numéro qu'elle avait monté a mal tourné, il y a de ça cinq ans. Elle est décédée peu de temps après de ses blessures. C'est le plus gros deuil du cirque depuis que Nico en est le directeur. Mon père a été très affecté par sa mort : Véra avait été son élève. Il en avait perdu sa bonne humeur ! Maintenant, tous les regards du cirque sont braqués sur Lorenzo et moi. Tout le monde espère tellement que l'on réussisse notre numéro ! Nous aussi, d'ailleurs. Lorenzo est sûr de le réussir. Je l'envie, car moi, j'ai peur de tomber de Perlita, la jument avec laquelle je travaille, ou de rater une de mes pirouettes. La honte que cela serait pour le cirque et pour moi ! Je n'ose même pas l'imaginer. Mais je suis tenu de rejoindre les jumelles : elles doivent m'attendre avec impatience pour répéter.
Quelques heures plus tard
Début du spectacle
Derrière le rideau d'entrée
Début du spectacle
Derrière le rideau d'entrée
« - Lorenzo ! chuchotai-je. Lorenzo !
- Qu'y a t-il ?
- Tu as vu tout ce monde ? La moitié de Florence au moins doit être venue nous voir. J'ai le trac !
- Ne t'en fais pas, tu es parfaite. Si tous les spectateurs n'applaudissent pas ton numéro, je veux bien que Vasco me change en lapin !, lança pour plaisanter Lorenzo.
- Tu es méchant de moquer de moi ainsi, tu sais parfaitement que je n'aime pas ça ! répliquai-je d'un ton faussement offensé.
- Alors, pour m'excuser, laisse-moi attacher ceci à ton cou, déclara-t-il en sortant de sa poche un objet que j'identifiai immédiatement.
- La médaille porte-bonheur de ta mère ! Lorenzo, il ne fallait pas! m'exclamai-je en sautant à son cou.
- Je voulais te la donner plus tôt, mais mon père m'a retenu longtemps après la répétition. »
Dehors, le spectacle se déroulait sans incidents, et c'était bientôt le tour des trapézistes dont Lorenzo faisait partie.
« - Mais pourquoi me l'offrir à moi ?, l'interrogeai-je.
- Lorenzo, active-toi, c'est à notre tour d'entrer en piste ! nous interrompit Silvio.
-Une minute, papa ! » lança Lorenzo, puis, se retournant vers moi, murmura : « Je voulais t'offrir cette médaille... »
Il s'interrompit, l'air gêné. Que voulait-il donc me dire ? « Lorenzo !!!, s'énerva Silvio
- Je voulais de la donner parce qu'il y a un recruteur qui va assister à nos numéros », lâcha-t-il, puis il partit en courant rejoindre son père, me laissant la médaille dans la main. Cette déclaration me fit l'effet d'une bombe. Je m'empressai de le rejoindre, mais il était déjà rentré en piste. Je le regardais donc enchaîner ses acrobaties avec son père et ma mère quand je le vis, le drôle de personnage qui était là, dans le coin, c'était un de ceux que mon père appelle « les recruteurs », des personnes qui essayent de trouver de nouveaux enfants prodiges du cirque. Ils financent l'entrée de ceux-ci dans les plus grandes et les meilleures écoles du cirque. On rêve tous, nous, enfants de la piste, d'être remarqués par ces personnes-là. En décelant une lueur briller au fond des yeux du recruteur, je fus certaine que Lorenzo s'était distingué. A la fin de son numéro, il fut évident que ce recruteur l'emmènerait : le déchaînement de la foule était grandiose, Lorenzo fut obligé de revenir trois fois sur la piste avant que le dernier numéro, mon numéro, ne soit annoncé. Je comprenais mieux maintenant pourquoi il m'avait donné cette médaille : il voulait mettre le plus de chance de mon côté pour que je sois également repérée. C'était décidé : je donnerais tout pour voir une lueur dans les yeux du recruteur briller pour moi et pour prouver à Lorenzo que j'étais digne de sa confiance. À ce moment-là, je sentis une main se poser sur mon épaule. C'était Viola. Elle me montra Perlita d'un mouvement de tête. Je compris que c'était à mon tour de renter en piste avec elle et sa sœur. Je fis donc mon entrée sur le dos de Perlita, accompagnée des sœurs sur leur cheval respectif. Et parvenue au centre du cercle, j'enchaînai les mouvements sur la musique. Plus de trac, envolée la peur, je donnai tout ce que j'avais. Lorenzo me dira plus tard qu'il n'avait trouvé qu'un adjectif pour me décrire alors : féerique. Même maintenant, je pense toujours qu'il a exagéré. Vint le final. Viola, Violetta et moi descendîmes de cheval en enchaînant une roulade pour nous retrouver ensuite face au public. Silence absolu. Puis un tonnerre d'applaudissement retentit, suivi des hourra de la foule émerveillée par notre prestation. Et je vis dans les yeux du recruteur de l'admiration. J'étais soulagée, europhique mais étonnée d'avoir réussi. La suite se déroula comme dans un rêve, et je n'en garderais que peu de souvenirs. Je me souviens avoir dû, comme Lorenzo, faire trois fois le tour dela piste avant d'en sortir. Tout le monde nous félicita. Je vis le recruteur arriver vers nous, un étrange sourire de contentement flottant sur ses lèvres.
- Qu'y a t-il ?
- Tu as vu tout ce monde ? La moitié de Florence au moins doit être venue nous voir. J'ai le trac !
- Ne t'en fais pas, tu es parfaite. Si tous les spectateurs n'applaudissent pas ton numéro, je veux bien que Vasco me change en lapin !, lança pour plaisanter Lorenzo.
- Tu es méchant de moquer de moi ainsi, tu sais parfaitement que je n'aime pas ça ! répliquai-je d'un ton faussement offensé.
- Alors, pour m'excuser, laisse-moi attacher ceci à ton cou, déclara-t-il en sortant de sa poche un objet que j'identifiai immédiatement.
- La médaille porte-bonheur de ta mère ! Lorenzo, il ne fallait pas! m'exclamai-je en sautant à son cou.
- Je voulais te la donner plus tôt, mais mon père m'a retenu longtemps après la répétition. »
Dehors, le spectacle se déroulait sans incidents, et c'était bientôt le tour des trapézistes dont Lorenzo faisait partie.
« - Mais pourquoi me l'offrir à moi ?, l'interrogeai-je.
- Lorenzo, active-toi, c'est à notre tour d'entrer en piste ! nous interrompit Silvio.
-Une minute, papa ! » lança Lorenzo, puis, se retournant vers moi, murmura : « Je voulais t'offrir cette médaille... »
Il s'interrompit, l'air gêné. Que voulait-il donc me dire ? « Lorenzo !!!, s'énerva Silvio
- Je voulais de la donner parce qu'il y a un recruteur qui va assister à nos numéros », lâcha-t-il, puis il partit en courant rejoindre son père, me laissant la médaille dans la main. Cette déclaration me fit l'effet d'une bombe. Je m'empressai de le rejoindre, mais il était déjà rentré en piste. Je le regardais donc enchaîner ses acrobaties avec son père et ma mère quand je le vis, le drôle de personnage qui était là, dans le coin, c'était un de ceux que mon père appelle « les recruteurs », des personnes qui essayent de trouver de nouveaux enfants prodiges du cirque. Ils financent l'entrée de ceux-ci dans les plus grandes et les meilleures écoles du cirque. On rêve tous, nous, enfants de la piste, d'être remarqués par ces personnes-là. En décelant une lueur briller au fond des yeux du recruteur, je fus certaine que Lorenzo s'était distingué. A la fin de son numéro, il fut évident que ce recruteur l'emmènerait : le déchaînement de la foule était grandiose, Lorenzo fut obligé de revenir trois fois sur la piste avant que le dernier numéro, mon numéro, ne soit annoncé. Je comprenais mieux maintenant pourquoi il m'avait donné cette médaille : il voulait mettre le plus de chance de mon côté pour que je sois également repérée. C'était décidé : je donnerais tout pour voir une lueur dans les yeux du recruteur briller pour moi et pour prouver à Lorenzo que j'étais digne de sa confiance. À ce moment-là, je sentis une main se poser sur mon épaule. C'était Viola. Elle me montra Perlita d'un mouvement de tête. Je compris que c'était à mon tour de renter en piste avec elle et sa sœur. Je fis donc mon entrée sur le dos de Perlita, accompagnée des sœurs sur leur cheval respectif. Et parvenue au centre du cercle, j'enchaînai les mouvements sur la musique. Plus de trac, envolée la peur, je donnai tout ce que j'avais. Lorenzo me dira plus tard qu'il n'avait trouvé qu'un adjectif pour me décrire alors : féerique. Même maintenant, je pense toujours qu'il a exagéré. Vint le final. Viola, Violetta et moi descendîmes de cheval en enchaînant une roulade pour nous retrouver ensuite face au public. Silence absolu. Puis un tonnerre d'applaudissement retentit, suivi des hourra de la foule émerveillée par notre prestation. Et je vis dans les yeux du recruteur de l'admiration. J'étais soulagée, europhique mais étonnée d'avoir réussi. La suite se déroula comme dans un rêve, et je n'en garderais que peu de souvenirs. Je me souviens avoir dû, comme Lorenzo, faire trois fois le tour dela piste avant d'en sortir. Tout le monde nous félicita. Je vis le recruteur arriver vers nous, un étrange sourire de contentement flottant sur ses lèvres.
Le lendemain de la représentation
Dans ma roulotte
Sur mon lit, mon bagage posé à même le sol, je regardai la roulotte qui m'avait vu grandir, enregistrant le moindre détail. Un de mes vieux dessins encadré et accroché près de la fenêtre, les rideaux rouges à pois blanc... Lorenzo devait faire de même. En effet, après une discussion avec mes parents, ceux de Lorenzo et le directeur, il fut décidé avec le recruteur, qui, comme je devais l'apprendre plus tard, s'appelait Mario Fabreschi, qu'il nous emmènerait à l'école de « La Scuola di Cirko di Torino », à Turin. J'avais hâte de partir, mais en même temps, je savais que quitter ma famille, mes amis, l'endroit qui m'avait vu grandir, serait douloureux. Soudain, j'entendis ma mère m'appeler. Ça y est, je vais partir pour des années d'apprentissage à Turin ! Je sortis de la roulotte les larmes aux yeux et rejoignis lentement Lorenzo et le recruteur. J'aperçus tous ceux du cirque, venus pour nous dire au revoir. Je grimpai dans la voiture du recruteur, suivie par Lorenzo. Le recruteur monta à l'avant, et démarra la voiture. Nous partîmes, accompagnés par les pleurs de nos mères au cœur déchiré. Puis les pleurs faiblirent à mesure que nous nous éloignions du cirque. Lorenzo et moi jetâmes un dernier regard au cirque Della Luna puis nous nous retournâmes, prêts à affronter notre destin.
sujet 2, prix « poème »
Damien HERIT, collège de la Chataigneraie, Autun
Le cirque en voyage
Les voilà arrivés, d'un long et grand voyage,
Venus de Roumanie, ils débarquent sur la place.
Montant leur chapiteau qui paraît bien tenace,
Tenant leurs animaux, enfermés dans les cages.
Les voilà arrivés, ils vont passer à l'acte.
Une salle gigantesque, remplie d'un riche public.
Des artistes fantastiques, tels des notes en musique.
Mais elle vient déjà la belle heure de l'entracte.
Une salle gigantesque, remplie d'un riche public.
Des artistes fantastiques, tels des notes en musique.
Mais elle vient déjà la belle heure de l'entracte.
Les voilà revenus, après un bon repas,
Ils reprennent le spectacle sur la scène pas à pas
Arrivé vers la fin, le public applaudit.
Ils reprennent le spectacle sur la scène pas à pas
Arrivé vers la fin, le public applaudit.
Les voilà, s'en vont dans leur grand bungalow,
Ils retournent chez eux vers leur famille au chaud.
J'espère qu'ils reviendront nous revoir un samedi.
Niveau 3ème
sujet 1
Aline PEYNET, collège Ronsard, L’Haye les Roses
Ne pas oublier…
C'est le soir de Noël. Toute la famille est installée près de la cheminée, dans la chaleureuse bastide de mes grands-parents. Le feu crépite. Au-dessus de l'âtre trônent des photos familiales.
Nous, les enfants, sommes assis par terre, devant le fauteuil à bascule en bois sculpté de Grand-Mère. Juste derrière, sur le canapé, mes oncles et tantes bavardent en riant, alors que nous nous sommes tus depuis quelques minutes déjà. C'est le rituel. Les yeux clos, Grand-Mère remonte le temps, elle médite à la façon dont elle va tourner les choses cette année. Son but, nous faire réfléchir aux conséquences de nos actes.
Elle rouvre les yeux, les adultes se taisent à leur tour.
« Tout a débuté lorsque j'avais dix ans, comme certains d'entre vous. J'allais à l'école presque tous les jours, car j'avais trois frères et deux sœurs plus âgés qui aidaient mes parents à la ferme.
Le matin du samedi 1er août 1914, après nous être occupés des bêtes, mon petit frère Gabriel, ma sœur Gisèle de deux ans mon aînée et moi, sommes partis rejoindre les moissonneurs avec le repas du midi dans des paniers. Soudain, la cloche de l'église du village, situé à plus de deux kilomètres, se mit à sonner. Alors que nous arrivions aux abords du champ, nous avons vu mon frère, André, un grand gaillard qui avait déjà dix-neuf ans, partir en courant. « Je vais voir ce qu'il se passe » nous cria-t-il en suivant les voisins qui prenaient la route du village. Lorsqu'il revint atterré, il parla longuement avec mon père et mes deux autres frères, Auguste et Léon, âgés respectivement de dix-sept et vingt et un ans. Mon père commença à s'emporter et nous perçûmes des bribes de phrases, parlant de mobilisation et de guerre. Nous n'en avons appris plus qu'au moment du dîner, ils avaient tous repris le travail comme si de rien n'était. Mais mon père ne décolérait pas. Ce soir-là, mes parents nous apprirent que nous, les plus jeunes, devrions aider beaucoup plus aux travaux des champs que nous ne le faisions les années précédentes. Nos deux frères aînés partaient à la guerre, et Auguste les y rejoindrait probablement bientôt, car il aurait dix-huit ans en octobre.
Mon père, qui heureusement échappait à la mobilisation, les accompagna à la ville deux jours plus tard pour qu'ils se présentent au bureau de recrutement. En partant de la maison pour rejoindre les autres jeunes du village, ils paraissaient confiants. Ce n'était que l'affaire de quelques mois, disaient-ils.
Nous avons donc continué pendant plusieurs semaines les moissons, plus difficilement que les autres années, car il nous manquait quatre bras costauds. Un grand malheur s'abattit alors sur nous à la fin de l'été. N'ayant pas été assez vite pour rentrer le foin dans la grange, une partie de notre récolte fut détruite par la pluie. A la rentrée, seul mon frère Gabriel put retourner en classe, car il n'était pas suffisamment âgé pour être utile et gênait sans s'en rendre compte les adultes par ses jeux. Le maître de la petite école communale ne s'offusqua pas de mon départ, il avait l'habitude de voir aller et venir ses élèves au gré des saisons.
Un peu avant la mi-octobre, j'y retournai également, les travaux des champs étant terminés. Cela ne dura pas. En effet, Auguste, qui venait d'avoir ses dix-huit ans, avait été appelé au front. J'en fus très attristée, non seulement parce que je ne pouvais plus aller en classe, mais aussi car c'était mon frère préféré. C'était le seul qui avait une attention pour nous, les petits, il nous parlait comme à des adultes, car il pensait que nous pouvions tout comprendre. De plus, nous n'avions toujours pas de nouvelle d'André et Léon, ce qui inquiétait grandement mon père, qui devenait très irritable.
Ma sœur Jeanne, âgée de quatorze ans, était désormais la plus grande. Nous avions de sérieux problèmes pour nous occuper des animaux. Nous les avions laissés aux prés le plus longtemps possible, mais les grands froids arrivaient et nous ne pouvions plus nous le permettre. Cela ne présageait rien de bon, selon mon père. Si le froid persistait autant que l'année dernière, nous n'aurions pas assez de foin pour nourrir les bêtes tout l'hiver.
Nous avons passé un Noël sans joie, sans festivités, à nous inquiéter. Nous n'avions pas de nouvelles de mes frères depuis le début de la guerre, mais nous savions que leurs régiments se déplaçaient beaucoup à cause des Allemands. Comme le disait mon père, qui se voulait rassurant, « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Au moins ils n'étaient pas morts, sinon on nous aurait avertis.
Nous avons reçu une lettre d'André début mars 1915, nous annonçant qu'il allait bientôt rentrer en permission. Lorsqu'il arriva, nous ne le reconnûmes d'abord pas, car il avait changé. Il avait beaucoup maigri, et possédait une épaisse barbe noire de plusieurs semaines. Mon père l'accueillit en héros, mais mon frère refusa de nous parler de ce qu'il se passait là-bas, au front. Il nous disait que c'était trop atroce. A ce moment-là, certains villageois nous haïssaient presque, aucun des nôtres n'étant mort pour l'instant. Rares étaient les familles qui n'avaient perdu aucun fils ; la guerre faisait des ravages. André repartit rapidement, car le voyage était long jusqu'à son régiment. Même s'il n'avait jamais été très bavard, il s'était beaucoup refermé sur luimême. L'étincelle de vie dans ses yeux s'était éteinte, ensevelie par les horreurs qu'il voyait au quotidien.
La joie de le savoir sain et sauf fut rapidement balayée. Deux mois plus tard, nous recevions la visite du maire nous annonçant que Léon était mort. Nous n'avons pas pu récupérer son corps, car il avait été déchiqueté par un obus. Nous l'avons pleuré plusieurs semaines, et rien ne tarissait les larmes de mon père, qui semblait pourtant insensible habituellement. Il souffrait énormément de la perte de son fils aîné, avec qui il s'était toujours bien entendu.
Il allait tous les jours au village, pour glaner quelques informations, mais les nouvelles étaient rares. Effectivement, dans ce petit coin reculé de France, nous n'avions pas beaucoup de renseignements sur la guerre et son déroulement.
La fin de l'année se passa sans accroc, si l'on excepte le fait que les moissons furent moins bonnes que les années précédentes. Nous recevions quelques lettres d'Auguste et d'André, qui ne se plaignaient pas, nous disant de ne pas nous inquiéter.
Nous avons passé un second Noël séparés, car la permission accordée à Auguste lui avait été retirée à cause d'une bataille qui nécessitait tous les hommes de son régiment. Nous avions l'impression que cette guerre ne s'arrêterait jamais. En février, nous avons appris qu'Auguste et André étaient envoyés à Verdun.
Vers la fin de l'hiver, nous manquions de nourriture. Les prix avaient augmenté et nous mangions à peine, une seule fois par jour, pour économiser. Mes parents décidèrent de placer mes deux sœurs, âgées maintenant de quinze et seize ans. Ma mère les emmena un jour, car elle leur avait trouvé des places dans des maisons bourgeoises, qui cherchaient des bonnes. Il ne restait désormais plus que Gabriel, qui avait presque neuf ans, et moi comme enfants à la maison. Gabriel avait commencé à comprendre la gravité de la situation. Il aidait de plus en plus aux travaux de la ferme, tout en faisant ses devoirs. C'était un garçon très intelligent. Plus tard, il réussit à obtenir une bourse et fit une école d'ingénieur.
Le matin du samedi 1er août 1914, après nous être occupés des bêtes, mon petit frère Gabriel, ma sœur Gisèle de deux ans mon aînée et moi, sommes partis rejoindre les moissonneurs avec le repas du midi dans des paniers. Soudain, la cloche de l'église du village, situé à plus de deux kilomètres, se mit à sonner. Alors que nous arrivions aux abords du champ, nous avons vu mon frère, André, un grand gaillard qui avait déjà dix-neuf ans, partir en courant. « Je vais voir ce qu'il se passe » nous cria-t-il en suivant les voisins qui prenaient la route du village. Lorsqu'il revint atterré, il parla longuement avec mon père et mes deux autres frères, Auguste et Léon, âgés respectivement de dix-sept et vingt et un ans. Mon père commença à s'emporter et nous perçûmes des bribes de phrases, parlant de mobilisation et de guerre. Nous n'en avons appris plus qu'au moment du dîner, ils avaient tous repris le travail comme si de rien n'était. Mais mon père ne décolérait pas. Ce soir-là, mes parents nous apprirent que nous, les plus jeunes, devrions aider beaucoup plus aux travaux des champs que nous ne le faisions les années précédentes. Nos deux frères aînés partaient à la guerre, et Auguste les y rejoindrait probablement bientôt, car il aurait dix-huit ans en octobre.
Mon père, qui heureusement échappait à la mobilisation, les accompagna à la ville deux jours plus tard pour qu'ils se présentent au bureau de recrutement. En partant de la maison pour rejoindre les autres jeunes du village, ils paraissaient confiants. Ce n'était que l'affaire de quelques mois, disaient-ils.
Nous avons donc continué pendant plusieurs semaines les moissons, plus difficilement que les autres années, car il nous manquait quatre bras costauds. Un grand malheur s'abattit alors sur nous à la fin de l'été. N'ayant pas été assez vite pour rentrer le foin dans la grange, une partie de notre récolte fut détruite par la pluie. A la rentrée, seul mon frère Gabriel put retourner en classe, car il n'était pas suffisamment âgé pour être utile et gênait sans s'en rendre compte les adultes par ses jeux. Le maître de la petite école communale ne s'offusqua pas de mon départ, il avait l'habitude de voir aller et venir ses élèves au gré des saisons.
Un peu avant la mi-octobre, j'y retournai également, les travaux des champs étant terminés. Cela ne dura pas. En effet, Auguste, qui venait d'avoir ses dix-huit ans, avait été appelé au front. J'en fus très attristée, non seulement parce que je ne pouvais plus aller en classe, mais aussi car c'était mon frère préféré. C'était le seul qui avait une attention pour nous, les petits, il nous parlait comme à des adultes, car il pensait que nous pouvions tout comprendre. De plus, nous n'avions toujours pas de nouvelle d'André et Léon, ce qui inquiétait grandement mon père, qui devenait très irritable.
Ma sœur Jeanne, âgée de quatorze ans, était désormais la plus grande. Nous avions de sérieux problèmes pour nous occuper des animaux. Nous les avions laissés aux prés le plus longtemps possible, mais les grands froids arrivaient et nous ne pouvions plus nous le permettre. Cela ne présageait rien de bon, selon mon père. Si le froid persistait autant que l'année dernière, nous n'aurions pas assez de foin pour nourrir les bêtes tout l'hiver.
Nous avons passé un Noël sans joie, sans festivités, à nous inquiéter. Nous n'avions pas de nouvelles de mes frères depuis le début de la guerre, mais nous savions que leurs régiments se déplaçaient beaucoup à cause des Allemands. Comme le disait mon père, qui se voulait rassurant, « Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». Au moins ils n'étaient pas morts, sinon on nous aurait avertis.
Nous avons reçu une lettre d'André début mars 1915, nous annonçant qu'il allait bientôt rentrer en permission. Lorsqu'il arriva, nous ne le reconnûmes d'abord pas, car il avait changé. Il avait beaucoup maigri, et possédait une épaisse barbe noire de plusieurs semaines. Mon père l'accueillit en héros, mais mon frère refusa de nous parler de ce qu'il se passait là-bas, au front. Il nous disait que c'était trop atroce. A ce moment-là, certains villageois nous haïssaient presque, aucun des nôtres n'étant mort pour l'instant. Rares étaient les familles qui n'avaient perdu aucun fils ; la guerre faisait des ravages. André repartit rapidement, car le voyage était long jusqu'à son régiment. Même s'il n'avait jamais été très bavard, il s'était beaucoup refermé sur luimême. L'étincelle de vie dans ses yeux s'était éteinte, ensevelie par les horreurs qu'il voyait au quotidien.
La joie de le savoir sain et sauf fut rapidement balayée. Deux mois plus tard, nous recevions la visite du maire nous annonçant que Léon était mort. Nous n'avons pas pu récupérer son corps, car il avait été déchiqueté par un obus. Nous l'avons pleuré plusieurs semaines, et rien ne tarissait les larmes de mon père, qui semblait pourtant insensible habituellement. Il souffrait énormément de la perte de son fils aîné, avec qui il s'était toujours bien entendu.
Il allait tous les jours au village, pour glaner quelques informations, mais les nouvelles étaient rares. Effectivement, dans ce petit coin reculé de France, nous n'avions pas beaucoup de renseignements sur la guerre et son déroulement.
La fin de l'année se passa sans accroc, si l'on excepte le fait que les moissons furent moins bonnes que les années précédentes. Nous recevions quelques lettres d'Auguste et d'André, qui ne se plaignaient pas, nous disant de ne pas nous inquiéter.
Nous avons passé un second Noël séparés, car la permission accordée à Auguste lui avait été retirée à cause d'une bataille qui nécessitait tous les hommes de son régiment. Nous avions l'impression que cette guerre ne s'arrêterait jamais. En février, nous avons appris qu'Auguste et André étaient envoyés à Verdun.
Vers la fin de l'hiver, nous manquions de nourriture. Les prix avaient augmenté et nous mangions à peine, une seule fois par jour, pour économiser. Mes parents décidèrent de placer mes deux sœurs, âgées maintenant de quinze et seize ans. Ma mère les emmena un jour, car elle leur avait trouvé des places dans des maisons bourgeoises, qui cherchaient des bonnes. Il ne restait désormais plus que Gabriel, qui avait presque neuf ans, et moi comme enfants à la maison. Gabriel avait commencé à comprendre la gravité de la situation. Il aidait de plus en plus aux travaux de la ferme, tout en faisant ses devoirs. C'était un garçon très intelligent. Plus tard, il réussit à obtenir une bourse et fit une école d'ingénieur.
Pendant cet été 1916, nous avons entendu des rumeurs, qui se trouvaient être fondées, sur la violence des combats à Verdun. Mes parents étaient de plus en plus inquiets. Nous avons travaillé aux champs tout l'été, mettant les bouchées doubles, car quatre paires de bras ne sont pas aussi efficaces que neuf. Nous avions moins semé que les années précédentes, par manque de temps. Nous avons quand même fait des récoltes honorables proportionnellement à notre nombre.
En septembre, alors que mon frère était à l'école, nous avons reçu une lettre. Une terrible nouvelle. Auguste avait été blessé très gravement lors d'un assaut à Verdun. Mon père s'est effondré après cela. « Cette guerre me prendra donc tous mes fils? » s'est-il lamenté. Gabriel nous a trouvé en pleurs en rentrant.
A sa sortie de l'hôpital, plusieurs mois après sa blessure, Auguste est revenu à la ferme. Il était méconnaissable. Son visage était déformé, il boitait terriblement et avait perdu son bras droit. Il parla à peine pendant des mois. Nous continuions à nous occuper de la ferme, mais il fallait également l'aider dans tous ses gestes quotidiens, comme pour manger et s'habiller.
Un an après, André est revenu en permission. C'était la deuxième fois que nous le voyions en quatre ans de guerre. Au village, rares étaient ceux qui avaient eu la chance de revenir deux fois, ils mouraient avant. Même s'il a essayé de ne pas le laisser paraître, le nouveau visage de son cadet l'a choqué. Il est reparti aussi vite que la première fois, car l'armée avait besoin d'hommes.
L'année 1918 se passa sans problème jusqu'à la fin octobre. De nouvelles rumeurs disaient que la guerre était sur le point de finir. Alors que nous apprenions la signature de l'armistice, le maire nous rendit visite. André avait participé à la bataille qui avait obligé les Allemands à capituler. Il était l'un des derniers morts de cette guerre... »
En septembre, alors que mon frère était à l'école, nous avons reçu une lettre. Une terrible nouvelle. Auguste avait été blessé très gravement lors d'un assaut à Verdun. Mon père s'est effondré après cela. « Cette guerre me prendra donc tous mes fils? » s'est-il lamenté. Gabriel nous a trouvé en pleurs en rentrant.
A sa sortie de l'hôpital, plusieurs mois après sa blessure, Auguste est revenu à la ferme. Il était méconnaissable. Son visage était déformé, il boitait terriblement et avait perdu son bras droit. Il parla à peine pendant des mois. Nous continuions à nous occuper de la ferme, mais il fallait également l'aider dans tous ses gestes quotidiens, comme pour manger et s'habiller.
Un an après, André est revenu en permission. C'était la deuxième fois que nous le voyions en quatre ans de guerre. Au village, rares étaient ceux qui avaient eu la chance de revenir deux fois, ils mouraient avant. Même s'il a essayé de ne pas le laisser paraître, le nouveau visage de son cadet l'a choqué. Il est reparti aussi vite que la première fois, car l'armée avait besoin d'hommes.
L'année 1918 se passa sans problème jusqu'à la fin octobre. De nouvelles rumeurs disaient que la guerre était sur le point de finir. Alors que nous apprenions la signature de l'armistice, le maire nous rendit visite. André avait participé à la bataille qui avait obligé les Allemands à capituler. Il était l'un des derniers morts de cette guerre... »
Grand-Mère ferme les yeux et respire profondément. Une larme coule sur sa joue. Elle se lève. Nous respectons une minute de silence, comme le veut la tradition, pour tous ces morts. Puis, tranquillement, nous allons chercher nos cadeaux au pied du sapin.
L'histoire est finie, la vie a repris son cours.
sujet 2, prix spécial du jury
Logan MARIN-VIDAL, collège du Vallon, Autun
Bois rouge
Chère porte rouge séparant mon monde de celui de mon frère,
Je te déteste tellement. Tu donnes beaucoup trop d'intimité à mon frère. S'il te plait, disparaît, ou perd au moins ta serrure. J'aimerais que Lucas arrête de s'enfermer dans sa chambre chaque fois qu'il se prend la tête avec mes parents... C'est à dire tous les jours.
Je suis en fait un peu jalouse, parce que je suppose que tu sais tout ce qu'il se passe pour lui, non ? Du haut de mes 15 ans, j'aimerais comprendre ce que Lucas subit au lycée pour rentrer avec une humeur de chien. En fait c'est un peu toi la confidente de mon frère. Enfin, s'il s'enferme dans sa chambre c'est qu'il a des secrets... Tu es un peu un coffre-fort... Et c'est bien pour ça que je te déteste. J'aimerais tellement que mon frère me parle à moi et m'explique tout ses problèmes. C'est pour ça que je ne t'aime pas.
La seule chose que je sais, c'est que ça se passe au lycée. Il a... Complètement changé à son arrivée au lycée. Avant ça il était... tellement bien. Mais depuis, les seules fois que je le vois c'est quand il me dépose au collège après un petit déjeuner où régnait un silence de mort. Pourtant, Dieu sait à quel point j'aime mon frère. Mais je ne sais pas quoi lui dire parce que je sais qu'il est détruit.
En fait il y a autre chose que je sais, c'est qu'il se... Il se fait du mal. J'ai vu les marques qui rongent ses poignets... ça me fait tellement du mal de savoir qu'il se... qu'il se mutile... Rien que d'y penser, j'ai la gorge qui se noue et le ventre qui se serre... Je savais bien avant de les voir qu'il avait mal, qu'il souffrait... Mais jamais je n'aurais pensé qu'il serait arrivé à un stade de désespoir où il se ferait souffrir seul. J'aimerais tellement être là pour lui. Je suis sûre que même avec notre différence d'âge, j'arriverais à le comprendre. Mais impossible de lui parler... J'en ai marre qu'il écoute toute la journée de la musique tellement fort qu'il en fait trembler les murs pour... s'évader je présume. J'en ai marre de m'endormir le soir en entendant mon frère pleurer, sangloter tellement fort que j'ai peur qu'il s'étouffe... J'en ai marre de ne pas pouvoir l'aider... J'en ai tout simplement marre d'en avoir marre.
Si tu n'existais pas, toi, je pourrais certainement l'aider. D'un côté je te déteste de me séparer de lui comme tu le fais et... de l'autre je t'admire... Tu dois sûrement prendre sur toi tous les secrets qu'il cache. Tout serait tellement plus simple si... Si tu pouvais parler, finalement. Tu pourrais m'expliquer la situation, me dire de quoi mon frère souffre et pourquoi il s'inflige cela. Pourquoi il se fait souffrir plus qu'il ne souffre déjà ? J'aimerais que tu disparaisses, que mon frère se souvienne que je suis sa sœur, que je suis là, que j'existe et que j'aimerais plus que tout au monde l'aider à remonter la pente.
Je cherche des solutions tous les jours pour comprendre le pourquoi du comment il se mutile. C'est peut être un appel au secours ? J'ai vu sur internet que certaines personnes se mutilaient dans l'espoir que quelqu'un le remarque. C'est des S.O.S en fait... Mais je n'ai pas envie d'aborder le sujet, je n'ose pas... J'ai tellement peur qu'il s'énerve après moi, qu'il se vexe, qu'il se renferme encore plus qu'il ne l'est déjà. J'ai pas envie de perdre mon frère... Même si je suis consciente que je le perds déjà petit à petit.
Je cherche des solutions tous les jours pour comprendre le pourquoi du comment il se mutile. C'est peut être un appel au secours ? J'ai vu sur internet que certaines personnes se mutilaient dans l'espoir que quelqu'un le remarque. C'est des S.O.S en fait... Mais je n'ai pas envie d'aborder le sujet, je n'ose pas... J'ai tellement peur qu'il s'énerve après moi, qu'il se vexe, qu'il se renferme encore plus qu'il ne l'est déjà. J'ai pas envie de perdre mon frère... Même si je suis consciente que je le perds déjà petit à petit.
Je ne sais pas pourquoi je te raconte tout ça alors que finalement, tu le sais déjà et que, malheureusement, tu ne peux pas lui faire passer mon appel au secours à moi. Je veux simplement retrouver mon frère et... l'aider à allez mieux. Je souffre de savoir qu'il est détruit.
Je voudrais juste que tu disparaisses, petite porte. Parce que je sais très bien que papa ne me laisserait jamais te casser et qu'il ne voudra jamais t'enlever. S'il te plaît, fais le pour moi et mon frère. Soit tu apprends à parler, soit tu disparais.
Lily
sujet n°2
Alice VERNAY, collège R.Doisneau, Châlon sur Saône.
2 Rue de l 'Evier
14 Février 2014
71110 - Châlon sur Saône
Bonjour, chère chose détestée,
Bonjour, chère chose détestée,
Je t'écris cette lettre pour que tu comprennes à quel point tu m'énerves et me dégoutes. Après chaque repas je te vois et je te maudis. Je voudrais fuir pour échapper à ce rendez-vous ! Te poser un lapin, mais le courage me manque !
Voilà il est 20h et nos peaux se caressent, la tienne, si molle, s'enfonce sous mes doigts. Le liquide que tu sécrètes dégouline quand je te presse. Sur la table ton corps s'aplatit grossièrement tel une limace. Ton odeur repoussante me donne la nausée. Je hais les petits creux qui parcellent ton dos et ta poitrine.
C'est alors que tu avales les saletés et les recrache dans ma main. Dégoutée, j'ai envie de te les jeter dessus mais je ne peux pas. Te couper, te mordre, te salir, te jeter, te cracher dessus ! J'ai tout essayé mais toi tu me fixes et je crois entendre ton rire moqueur. Le lendemain je pense ne plus te voir mais tu reviens toujours et tu trônes à ta place, dans le pot en porcelaine près de l'évier.
Alors je t'en supplie maudite et répugnante EPONGE épargne-moi ce supplice qu'est de laver la table !
Sincèrement,Alice
Niveau lycée
Sujet n°l, prix spécial du jury
Lola Beisbardt, lycée Jean XXIII, Montigny les Metz
Notre-Dame du désert
Seule, je vois la rue, et la rue me voit.
L'Histoire aurait dû rester une histoire, fictive et lointaine. Comme celle que l'on étudiait. Je m'en souviens encore, de mes mains qui tournaient les pages des livres, et de mes yeux fixés sur des tableaux défilants, squelettes, masques, faucheuses, progrès, industrie, squelettes. J'étais maladivement curieuse du passé, de la maladie, des famines, de ce Moyen-Age obscur et putride, laissé derrière nous. Intérêt pour les hommes-bêtes qui y habitaient.
Le progrès, aujourd'hui, nous l'avons. La maladie aussi. Et celle-ci détruit tout, méthodiquement, mathématiquement même ; elle rend insignifiante toutes ces radios qui débitent, débitent encore des chiffres. Un mort, cinq mort, dix mors, dix milliers de morts : une épidémie. Le mot a brisé avec nonchalance les écrans de télévision les plus solides, et nous a démoli le cerveau. E-Pi-De-Mie. Je suis pieuse, je me croyais à l'abri de tout. E-Pi-De-Mie. Nous nous croyions à l'abri de tout, en réalité.
Peste.
J'ai longtemps été poète, et je me suis toujours maintenue à la lisière de Dieu, de ses lèvres pâles ; mais je ne regardais pas derrière moi. Derrière moi, il y avait la science. La science devait tout protéger. La foi, la religion, la poésie.
Peste.
Peste.
Certains pensent qu'une é.pi.de.mie ne touche que les mauvais. Je ne sais pas qui : des ombres anonymes, dispersées au vent, qui laissent leur message sur les murs. Comme les religieuses et moi, nous touchons Dieu du bout de nos doigts, ils pensent que nous sommes insensibles. Alors nous nettoyons les corps dans la rue, armées de gants, seuls remparts contre la pourriture, la maladie, l'agonie, les limbes.
J'ai toujours été poète. Le glauque m'a, dès ma naissance, mordu les joues, prenant, pour me séduire, le visage d'un homme fou de haine - évoquant les cadavres éviscérés d'Artaud ou de Lautréamont. Séduite, je l'étais déjà. Maintenant, je charge un mort dans un camion. C'est un enfant, aux joues minces et acérées ; je suis trop mince pour porter autre chose que des enfants. Mais je ne vois rien, dans ce corps, je ne vois pas au travers ! Mes mains, tout ce qu'elles touchent, ce sont des valses de sang caillé et de cloques ; une raideur froide qui transit les os, et des yeux qui pourrissent lentement, enfermés dans un écrin de cils noirs. Si je ne peux pas imaginer, si je ne peux plus sentir, transcender, revivre les choses, suis-je encore poète ? Lautréamont, Artaud, eux, invoquent des cadavres et les raniment ; ils dansent au-dessus d'eux ; et leurs mains décharnées, leurs os béants, leurs crânes lobotomisés. A travers eux c'est tout une génération de morts qui survit, fastueuse et impérissable.
Je voudrais y survivre, moi aussi.
Un homme m'aide à charger le corps dans le camion- presque rempli, la pile est haute - puis disparait, entre deux ruelles, devenu fantôme translucide ; tout du moins, le corps trop fatigué pour renvoyer une quelconque lumière. Une femme déjà malade me regarde de sa fenêtre : son regard dit : « ce n'est pas votre foi qui nous sauvera, pauvres fous ». Dieu, Dieu, pourquoi dois-tu te laisser mystifier par les profanes, ces dévoreurs-de-ciel qui ne cherchent que le néant ?
Les religieuses sont tombées, l'une après l'autre. Seules leurs convictions - les miennes - résistent encore. A chaque cadavre, ce sont des images rouges putrides qui me bondissent en pleine figure, et je me dis « Dans combien de temps est-ce que ce sera mon tour ? Est-ce que si je meurs, je pourrais voir de plus près les lèvres de Dieu, les limbes de Dieu ? ». Mon époux ne me quitte plus. Maigre, lui aussi. Il ne veut pas que je sois seule. Ensemble, nous portons des corps de femme, et ils jonchent de plus en plus la ville, multipliés. Que reste-t-il du numérique, que reste-t-il du progrès ? Des laboratoires cachés, sans doute, où les scientifiques dansent comme des mouches.
Les religieuses sont tombées, l'une après l'autre. Seules leurs convictions - les miennes - résistent encore. A chaque cadavre, ce sont des images rouges putrides qui me bondissent en pleine figure, et je me dis « Dans combien de temps est-ce que ce sera mon tour ? Est-ce que si je meurs, je pourrais voir de plus près les lèvres de Dieu, les limbes de Dieu ? ». Mon époux ne me quitte plus. Maigre, lui aussi. Il ne veut pas que je sois seule. Ensemble, nous portons des corps de femme, et ils jonchent de plus en plus la ville, multipliés. Que reste-t-il du numérique, que reste-t-il du progrès ? Des laboratoires cachés, sans doute, où les scientifiques dansent comme des mouches.
Je suis seule, maintenant, on me claque les portes au nez, je suis une morte, je suis un croque-mort. La dernière religieuse m'a convoquée à son chevet. Elle agonise lentement- et l'air de sa gorge, aussi précieux que l'air de Dieu, crève lentement dans des relents paradisiaques. A côté d'elle, il y a cette croix qui m'a toujours rendue perplexe, la croix du couvent, fissurée, repliable en plusieurs morceaux. Sa main devient de plus en plus froide dans la mienne ; un moineau, sur la fenêtre, regarde la scène de cet œil inquiet de ceux qui sentent, continuellement, une épée leur transpercer le cœur, et se demandent quand elle pourra les achever.
-Prends ton époux, prends ton époux, et plantez cette croix au bout de votre mort, là où Dieu jugera vos efforts suffisants. Elle devra guérir tout... Elle devra guérir tous les maux.
- Est-ce qu'un homme et une femme suffiront pour cela ?
-Vous mourrez bientôt, dans tous les cas. La ville est morte, la science est morte. Dieu survit. Notre foi, elle aussi.
- Est-ce qu'un homme et une femme suffiront pour cela ?
-Vous mourrez bientôt, dans tous les cas. La ville est morte, la science est morte. Dieu survit. Notre foi, elle aussi.
Elle est morte quelques heures plus tard, allongée sur le sol, sans draps, comme le ferait une chienne abandonnée. Je n'ai pas lâché sa main. Je l'ai sentie se raidir, passant de l'état fugitif des limbes à Dieu, et je l'ai imaginée devenir os tournoyants, décomposés, blancs sans doute, entre mes doigts fins.
Je ne suis plus poète, maintenant, je le sais ; je suis transitoire de dieu, support d'écriture, d'un rêve éphémère déjà avorté.
Plus tard, bien plus tard, nous avons choisi le Sahara. Heureusement, il reste quelques avions à Paris, même si le chemin jusqu'à la lisière, jusqu'au bord de l'indicible, sera long.
Je ne suis plus poète, maintenant, je le sais ; je suis transitoire de dieu, support d'écriture, d'un rêve éphémère déjà avorté.
Plus tard, bien plus tard, nous avons choisi le Sahara. Heureusement, il reste quelques avions à Paris, même si le chemin jusqu'à la lisière, jusqu'au bord de l'indicible, sera long.
(Dans l'avion, j'ai pensé : je ne suis plus poète si tu ne sens plus ma langue âpre, qui lèche le feu de ne pouvoir dire, écrire encore, avec cette inspiration explicite de l'âme, je ne suis plus poète si ma langue est sèche comme le reste de mon corps.
Dans le désert, nous serons plus secs que jamais.)
Dans le désert, nous serons plus secs que jamais.)
Le guide nous a abandonné avant la lisière. J'ai l'eau et la nourriture dans mon sac, il a la croix dans le sien. Quand nous commençons à marcher, la seule idée qui s'imprime dans nos esprits, c'est celle de la mort ; ici ou là-haut, c'est mourir ; la seule différence est notre distance à Dieu. Mon époux peine à la sentir, mais je porte à chacun de ses doutes ses mains près de mon cœur, pour qu'il n'oublie pas ce que signifie aimer. Bientôt, mon esprit appréhende 1'horizon du désert comme le ferait mon corps ; il transforme l'instinct en un mélange de braises compactes et calcinées, le réduit à néant. Je suis calcinée. Déjà, après seulement quelques heures de marche : les rayons du soleil entament ma peau et les flammes courent sous mes os. Ma gorge se transperce et tout s'en écoule, tripes, cœur, poumons. Crachés méthodiquement en rafales, comme des volutes de fumées.
La nuit est pire.
C'est échapper à la chaleur lourde du jour pour heurter une chaleur diffuse, insidieuse, mais toujours plus vive.
Mon époux s'agite, et moi, je ne suis plus qu'un amas de chairs.
Je suis une victime du destin, de la vanité, et de ma foi. C'est cela que j'ai choisi. C'est toute mon histoire.
Après deux jours, j'ai compris. Nous errons. L'errance, ce ne sont pas ces silhouettes décrites dans les livres anciens, par les grecs ou les romains ; ce ne sont pas des âmes perdues, damnées à la va-vite, affleurant sur l'horizon comme des fleuves figés. L'errance, c'est simplement cheminer sans fin, au point que l'onirisme remplace peu à peu ce qu'il restait de réel, dans cette situation absurde - je ne peux pas recopier les verbes étranges qui me passent par le crâne, ce sont des éclairs. Et je ne suis plus poète. Ton dos fatigué refuse d'avancer encore et se casse net, te laissant, pantin à peine articulé, sur une dune. Je te relève. Nous marchons. Combien de temps encore ? Deux jours ? Quatre ? Deux ? Deux, sans doute.
Est-il encore mon époux, cette ombre crasse, avec ses cheveux sales?
Est-il encore mon époux, cette ombre crasse, avec ses cheveux sales?
Regarde nos yeux, ce sont juste des hologrammes.
Tous les enfants de Dieu ont besoin de chaussures pour vivre. Les nôtres s'usent lentement sur le sable.
Tous les enfants de Dieu ont besoin de chaussures pour vivre. Les nôtres s'usent lentement sur le sable.
La nuit est pire.
Mon époux commence à mourir lentement.
Je suis une africaine de peau, maintenant, noire, mate, ténébreuse. Vide.
Mon époux commence à mourir lentement.
Je suis une africaine de peau, maintenant, noire, mate, ténébreuse. Vide.
Au bout de quatre jours, nous nous sommes arrêtés et maintenant nous remontons la croix, difficilement, du bout de nos mains tremblantes - et de nos lèvres lorsque nos paumes ne tiennent plus. Chacun de nos souffles douloureux repousse la vie et la mort, les heurte, dans un élan viscéral. Enfin, nous la plantons, ensemble. Puis nous nous sommes écroulés. Squelettes déjà. Tu meurs en premier. Dans le désert, ta foi en moi coule comme une veine de charbon irrédente. Je regarde tes poumons qui ne se soulèvent plus, et j'ai comme envie de les découvrir, d'en arracher la peau et les muscles. Mais je ne peux plus bouger.
J'ai trop donné mon corps au néant.
sujet 1
Lucie ROBLE, lycée Leon Blum, Le Creusot.
Elle s’appelait fait divers
Elle était partie, frêle brunette aux grands yeux, des espoirs plein la tête et des rêves plein le cœur. Les rues de la grande ville semblaient l'accueillir à bras ouverts. Petite fille romantique et naïve ne sachant pas ce que la vie pouvait lui réserver de mal. Elle était enfin arrivée au bout de son voyage.
Elle était revenue, blonde platine, les yeux cernés d'une couche charbonneuse, la peau pâle et le regard brisé. La ville qu'elle avait tant rêvée l'avait recrachée, elle et ses rêves.
Les talons de ses rangers claquaient durement sur le sol en bitume. Une besace élimée battant sa hanche au rythme de ses pas, elle regarda ses rues qui l'avaient vu grandir et soupira, elle savait qu'elle n'aurait jamais dû partir mais quelque chose au fond d'elle refusait de l'admettre.
Les talons de ses rangers claquaient durement sur le sol en bitume. Une besace élimée battant sa hanche au rythme de ses pas, elle regarda ses rues qui l'avaient vu grandir et soupira, elle savait qu'elle n'aurait jamais dû partir mais quelque chose au fond d'elle refusait de l'admettre.
Elle arriva devant une grande bâtisse blanche, la pelouse tondue, des barrières autour du petit jardin bien entretenu. La maison était un stéréotype à elle seule et la jeune femme lâcha un
énième soupir en avançant dans l'allée. Tout ce qui l'entourait était parfait. Trop parfait...
énième soupir en avançant dans l'allée. Tout ce qui l'entourait était parfait. Trop parfait...
Arrivée devant la porte bleu ciel, sa main se leva pour cogner la surface en bois, mais le mouvement de son poignet s'interrompit brutalement et elle se mordit la lèvre inférieure.
Cinq ans... C'était long, cinq ans... Et s'ils ne se souvenaient plus d'elle? S'ils la jetaient dehors ? Elle reprit courage et frappa. Après tout, lorsqu'on se trouvait au fond du caniveau, il était très difficile de tomber plus bas.
Cinq ans... C'était long, cinq ans... Et s'ils ne se souvenaient plus d'elle? S'ils la jetaient dehors ? Elle reprit courage et frappa. Après tout, lorsqu'on se trouvait au fond du caniveau, il était très difficile de tomber plus bas.
Elle entendit des bruits de pas et la porte s'ouvrit. Une jeune femme, les cheveux chocolat et le regard ambré la regardait en écarquillant les yeux.
«Salut... »
La femme face à elle semblait en état de choc et réussit à peine à bredouiller :
«Heu... Tu... Tu veux rentrer?»
La femme face à elle semblait en état de choc et réussit à peine à bredouiller :
«Heu... Tu... Tu veux rentrer?»
La blonde la bouscula d'un coup de coude, rentra dans la maison sans un mot de plus, puis pénétra dans le salon et s'assit en tailleur sur le canapé en cuir.
La pièce était presque entièrement dans les tons blancs, ce qui la dégoûta au plus haut point. Comment pouvait-on supporter de vivre dans cette atmosphère aussi immaculée et impersonnelle que celle des hôpitaux? Sa nervosité grandit en voyant les photos de famille regroupées sur le montant de la cheminée, bien alignées.
Son « hôte » arriva dans le salon et bafouilla une nouvelle fois :
« Qu'est-ce que tu... viens faire ici ? »
Elle lui jeta un regard vide de toute émotion avant de répondre d'une voix peu assurée:
« C'est pas à toi que je veux parler si tu veux tout savoir... Je veux juste de ses nouvelles...
- Je... Je ne vois pas de qui tu parles. »
Elle lui jeta un regard vide de toute émotion avant de répondre d'une voix peu assurée:
« C'est pas à toi que je veux parler si tu veux tout savoir... Je veux juste de ses nouvelles...
- Je... Je ne vois pas de qui tu parles. »
La blonde se releva d'un bond et s'approcha rapidement de l'autre femme, son regard brillant de menaces.
« Te moque pas de moi Catherine ! Tu sais très bien de qui je parle ! Où-est-il ? »
La-dite Catherine prit une grande respiration en essayant de limiter ses tremblements de frayeur. Elle avait tellement changé...
« Il... Il est parti... Je te jure que je ne sais pas où il est... >>
La jeune femme s'éloigna, sortit de sa poche arrière une cigarette qu'elle s'empressa d'allumer, ses ongles vernis de rouges tremblant légèrement en tenant le cylindre de papier. Elle tira précipitamment une taffe avant de se diriger vers la porte. Elle se retourna et planta ses prunelles bleues électriques dans celles de la brune.
« Il a détruit ma vie. Je pense que j'ai le droit de régler mes comptes avec lui... »
Et elle claqua la porte, inspirant avec délice la fumée de la cigarette alors que son regard se tournait vers le ciel. Elle fit quelques pas, sans remarquer que derrière ses rideaux de soie blancs, Catherine observait cette femme qu'elle n'avait plus vue depuis une éternité. Une fois au coin de la rue, elle jeta son mégot au loin, d'un geste rageur avant de continuer avec la même colère.
« Chienne de vie... »
Ses talons martelaient le rythme de son départ. Lourd et martial comme une marche funèbre.
Quelques jours plus tard, la fausse blonde platine s'asseyait à la terrasse d'un café, de grandes cernes violettes sous les yeux et le regard encore plus vide et opaque qu'à l'accoutumée. Elle commanda un café noir et le but par petites gorgées, regardant mélancoliquement les gens passer devant le bar-restaurant. Certains marchaient très vite, pressés par leur travail. Ils portaient des costumes sombres, parfaitement repassés et avaient toujours le nez collé à leur montre, comme s'ils étaient soumis plus que les autres à la loi immuable du temps qui passe.
Les adolescents marchaient en prenant leur temps, parlant et riant de tout et de rien. Elle se souvenait qu'un jour, elle avait été comme eux... Il y a fort longtemps.
Il y avait ceux qui se tenaient la main et là, elle ne pouvait s'empêcher de sentir une vague de douleur et de nostalgie l'envahir, dévastant le mur d'argile qu'elle avait mis toute une période de sa vie à construire dans le seul but de se protéger.
Ce qu'elle aimait par-dessus tout contempler, c'étaient les musiciens de rues. Ces personnes qui s'asseyaient au bord de la fontaine avec leurs guitares et qui commençaient à plaquer quelques accords, juste pour le plaisir de faire partager leur musique aux autres.
Elle soupira lassement. C'était devenu son activité préférée et elle ne comptait plus le nombre de fois où elle soupirait en une semaine. Elle avala d'une traite son café et s'apprêta à se lever quand un jeune homme s'assit en face d'elle.
Il était un peu plus vieux qu'elle, avait de courts cheveux bruns et de grands yeux noirs. Un costume autrefois chic mais désormais usé complétait le tableau.
Elle haussa un sourcil quand ce dernier l'accosta :
Il était un peu plus vieux qu'elle, avait de courts cheveux bruns et de grands yeux noirs. Un costume autrefois chic mais désormais usé complétait le tableau.
Elle haussa un sourcil quand ce dernier l'accosta :
« Marcus Stevens, Marc pour les intimes. Je suis journaliste. Et vous? »
- Ça te regarde pas. »
- Ça te regarde pas. »
Elle fut surprise de le voir éclater de rire à sa remarque. Habituellement elle n'avait pas de mal à faire fuir les hommes mais celui-là semblait différent.
« Qu'est-ce que tu me veux?
- Je veux écrire un article sur vous. »
- Je veux écrire un article sur vous. »
Ce fut à son tour d'éclater de rire en répliquant :
« Nan mais t'es malade ? Je vois déjà le titre : « comment ne pas finir sur le trottoir en 20 leçons » ! Et puis pourquoi sur moi ?
- Vous avez une... « Aura »... Particulièrement... »
- Vous avez une... « Aura »... Particulièrement... »
Le brun arrêta directement sa tirade quand son regard tomba sur le visage humide de la jeune femme. Les larmes coulaient sur ses joues pâles, faisant couler son maquillage noir sous ses yeux. Ce qui étonna le plus le journaliste était l'impassibilité du visage en pleurs. Telle une statue de marbre, elle ne semblait même pas remarquer que sa tristesse avait profité d'une faille pour se glisser au travers de ses paupières.
« Qu'est-ce que vous avez ? demanda-t-il, une pointe de panique dans la voix.
- Ce que j'ai ? »
- Ce que j'ai ? »
La voix était éraillée et aussi glaciale qu'un soir d'hiver. La blonde se releva lentement avec un calme presque inquiétant et continua de sa voix grave et profonde.
«Ce que j'ai ? La dernière personne qui m'a dit que j'avais du charisme, c'était mon ex. Bonne famille, respecté et tout et tout... Je l'ai suivi à Paris pour devenir chanteuse, mais personne ne m'avait dit que je n'avais aucun talent ! L'amour rend aveugle disait l'autre con et il était loin d'avoir tort ! Je me suis retrouvée au fond du caniveau, sans rien... J'étais une adolescente comme les autres ! J'étais conne comme les autres ! Quand j'ai pensé que je ne pouvais pas tomber encore plus bas, il m'a laissé. Je suis revenue, rampant comme la moins que rien que je suis... Et mes chers parents m'ont jetée dehors... Vous savez pourquoi ? Parce que j'avais eu le malheur de corrompre le « gentil » fils des voisins! Je suis repartie... J'ai reconstruit un semblant de vie... Et puis je suis revenue, je suis allée le voir. Je suis tombée sur sa débile de sœur qui m'a dit qu'elle ne savait rien ! T’aurais vu le dégoût dans son regard...
Tout a toujours été de ma faute. Je suis comme le sel dans le chocolat : je sers à rien ! »
Tout a toujours été de ma faute. Je suis comme le sel dans le chocolat : je sers à rien ! »
Elle prit la tasse de café du journaliste et lui lança à la figure avant de tourner les talons. Elle ne se retourna pas, même lorsqu'elle entendit le pauvre garçon hurler de douleur.
«Avant je laissais les gens m'utiliser...Mais faudrait voir à pas trop abuser ! »
Une phrase sur un vieux journal : Plus jamais se laisser faire.
Quatre mots griffonnés au coin d'une partition déchirée : Vivre selon ses choix.
Une identité écrite au stylo plume sur un formulaire de décès :
Amelia Lonbardi, 22 ans, suicide
Amelia Lonbardi, 22 ans, suicide
Sujet 2
Violette HERAUDET, Lycée La Prat’s, Cluny
L'Ailleurs au féminin
Ailleurs, une femme est battue
Ailleurs, deux femmes sont vendues,
Ailleurs, trois femmes sont humiliées,
Ailleurs, quatre femmes sont violées !
Ailleurs, une mère se sacrifie,
Ailleurs, une fille se scarifie,
Ailleurs, une amie joue sa vie,
Ailleurs, une épouse trompe son mari...
Ailleurs, une femme est convoitée,
Ailleurs, cette femme est charmée,
Ailleurs, elle est prête à se donner,
Alors, elle est finalement délaissée.
Aïe ! Heures, trop de femmes sont cachées !
Aïe ! Heures, trop de femmes sont tombées !
Ailleurs, chaque femme souffre,
Ailleurs, chaque femme s'essouffle...
Aïe ! Heures, trop de femmes sont tombées !
Ailleurs, chaque femme souffre,
Ailleurs, chaque femme s'essouffle...
Ici, une femme se relève,
Là-bas, deux femmes s'aiment,
Ailleurs d'autres en rêvent...
De toutes parts, chacune redevient Eve.
.